Les livres, les revues, etc.
Les livres, les revues, etc.
Éloge de George Woodcock (1912-1995), L’Anarchisme, Lux, 2019, 544 P.
Éloge, du moins, de son livre parce que voici une œuvre d’une grande clarté d’expression, tout en nuances, et d’une bonne qualité d’écriture ; ce livre fut publié dans les années 1960 aux États-Unis puis en Angleterre. Les Suédois l’éditèrent en 1964, les Italiens en 1966; grâce aux Canadiens, nous avons maintenant une édition en français de sa version revue en 1975.
En 1960, Woodcock estimait que le mouvement anarchiste classique était moribond ; la date de 1939, avec l’entrée des troupes franquistes dans Barcelone mettant, pour lui, un point final à l’histoire des organisations libertaires. Pour autant, il distinguait « l’idée » du « mouvement », idée qui réapparaîtrait un jour ou l’autre sous une forme différente.
En effet, si, alors, il considérait qu’il n’y avait aucun intérêt à « recréer des formes d’organisation obsolètes ou d’imiter des méthodes insurrectionnelles qui avaient échoué », c’est en retenant la notion essentielle de dignité, « se tenir debout ! », c’est en rappelant, après la défaite makhnoviste, le propos d’Archinov s’adressant « aux prolétaires du monde entier » :
Portez le regard au plus profond de votre être, cherchez la vérité et concrétisez-la vous-même. Vous ne la trouverez nulle part ailleurs qu’en vous.
C’est au moment même où son livre, à la tournure désenchantée, paraît en Angleterre - où il a participé au journal Freedom - qu’il constate, lors de la campagne de désobéissance civile pour le désarmement nucléaire avec le Comité des 100, un renouveau : la présence de 500 jeunes anarchistes « barbus et chevelus », rassemblés sous le drapeau noir et défilant dans les rues de Londres. Puis c’est aux Pays-Bas qu’il verra le mouvement des Provos réinventer la propagande par le fait par des pratiques originales (« Nous sommes d’accord avec le fait d’être en désaccord », disent-ils). Pour Woodcock, la « souplesse idéologique des Provos tend à devenir une caractéristique générale du “nouvel” anarchisme qui se répand dans les années 1960 ». Il s’agit d’être « à l’écoute des enjeux de son temps ».
Woodcock se sent alors obligé de rendre compte de cette évolution de l’anarchisme, de sa survie ; obligé de revoir son texte et de le mettre à jour, il conçoit que l’anarchisme, idée essentiellement antidogmatique, se révèle fluide et avec une capacité de renaître avec le temps sous d’autres formes. L’essentiel, pour les anarchistes, étant qu’« une bonne partie de leurs efforts intellectuels est consacrée à la recherche d’un équilibre entre la solidarité humaine et la liberté individuelle ».
Il va tout d’abord tracer ce qu’il nomme « l’arbre généalogique » plus ou moins mythique de l’anarchisme. Mais pas seulement puisqu’il cite Gerrard Winstanley (1609-1676).
Quiconque détient l’autorité tyrannise autrui ; comme le font tant de maris, de parents, de maîtres et de magistrats qui vivent selon la chair, ils se comportent comme des seigneurs oppresseurs envers leurs subordonnés, ignorant que leurs épouses, leurs enfants, leurs serviteurs et leurs sujets sont leurs semblables et ont le même droit à la bénédiction de la liberté.
Il y aura donc des éditions successives qui garderont cependant la structure première de son livre, travail très pédagogique qui met en avant six personnages avec l’évolution de leur pensée, mais avec aussi aussi une description de leurs caractères propres, tout en citant les rencontres qu’ils firent leur vie durant :
-
William Godwin (1756-1836), « le rationnel » ; une trentaine de pages lui sont consacrées bien qu’il rejette le terme d’« anarchiste » comme péjoratif tout en associant propriété et pouvoir (capitalisme et État) ; son parcours de vie, menant ce fils de pasteur à l’athéisme, est fouillé philosophiquement en le situant dans la lignée des dissidents religieux qui préfèrent « la persuasion morale et la résistance passive à la résistance violente et active ».
-
Max Stirner (1806-1856), « l’égoïste ». Ce qui frappe chez lui, c’est le contraste entre une vie relativement décevante et malchanceuse au regard d’une œuvre qui exalte l’individualisme extrême (« Mes actes n’ont rien de politique ni de social, n’ayant d’autre objet que moi et mon individualité ») ; ses textes prônent une violence - chez lui refoulée -, de même que la lutte insurrectionnelle (« Aussi, l’État et Moi sommes-nous ennemis »), le tout compensé par « l’association des égoïstes ».
-
Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), « le paradoxal », aux formules chocs comme « La propriété, c’est le vol ! », formule qu’il nuancera en développant les notions de « possession » et de « propriété », en conciliant, ou pas, les contradictions de la réalité pour construire ses idées. Si, pour Proudhon, l’individu est le point de départ et l’objectif, le rapport entre eux constitue un « équilibre délicat », mais c’est avec la volonté de rendre possible la création d’associations d’artisans, de paysans et de travailleurs industriels (ces derniers avec qui il s’est familiarisé après son séjour à Lyon), c’est en prônant le fédéralisme, les mutuelles, etc. Ses écrits et son action feront de lui « l’ancêtre direct du mouvement anarchiste organisé ».
-
Michel Bakounine (1814-1876), « le destructeur » - également précurseur de l’anarchisme organisé -, habité d’un feu libertaire et généreux qui écrit : « Faisons donc confiance à l’Esprit éternel qui ne détruit et n’anéantit que parce qu’il est la source insondable et éternellement créatrice de toute vie. La passion de la destruction est en même temps une passion créatrice. »
-
Pierre Kropotkine (1842-1921), « le géographe », sensible à l’évolutionnisme de Darwin, qui, nous dit Woodcock, prendra dès 1891 ses distances avec les tactiques violentes en affirmant que l’anarchisme pourra se concrétiser « lorsque l’opinion publique aura mûri et avec le moins possible de troubles ».
-
Léon Tolstoï (1828-1910), « le prophète » ; ce dernier, déiste, et pour cela négligé par des militants qui avancent le slogan « Ni dieu ni maître ! ». Pour Tolstoï, l’anarchisme est synonyme de violence, « bien que son opposition catégorique à l’État et à d’autres formes d’autorité situe indéniablement ses idées dans l’orbite libertaire », écrit Woodcock.
Il n’empêche que nombre d’autres militants très connus seront cités.
Après un panorama historique de l’anarchisme international, quatre pays (France, Italie, Espagne et Russie) ont droit chacun à un chapitre, tandis que sont réunis en une seule partie l’Amérique latine, l’Europe septentrionale, la Grande-Bretagne et les États-Unis.
À propos de la France, Woodcock écrit :
Les événements de 1968 montrent admirablement comment des idées et des tactiques anarchistes peuvent émerger spontanément d’un mouvement dont la plupart des acteurs ne se considèrent pas comme des anarchistes et ne connaissent guère l’histoire ou les classiques de la doctrine.
En 1941, Woodcock dirige la revue littéraire et pacifiste Now ; ce qui explique que tout au long du livre, cette orientation anarcho-pacifiste sera parfaitement visible, même s’il maintient la plus grande objectivité envers les tendances violentes. L’expression « résistance passive » - terme malheureux, inadéquat et dépassé - se retrouve çà et là.
Il note, pour l’Allemagne, qu’au XXe siècle, à la tendance collectiviste « succède un anarcho-syndicalisme modéré, non-violent, caractérisé par l’efficacité et la rigueur ». Si, au Pays-Bas et en Suède, existe une tendance anarcho-syndicaliste révolutionnaire, elle s’accompagne d’un pacifisme très actif.
Dans les années 1960, en Grande-Bretagne, c’est la revue Anarchy qui « se fait la porte-parole d’un anarchisme renouvelé, affranchi de toute loyauté doctrinaire au mouvement historique et sensible aux urgences du moment » ; il s’agit surtout de « la recherche constante, ici et maintenant, d’occasions de mettre en œuvre les principes de l’anarchisme ».
Les États-Unis sont partagés entre l’influence d’un Thoreau, celle des communautés « utopiques », ou colonies, et le courant violent que propagea Johann Most, « aux conséquences funestes sur la suite des événements », écrit Woodcock. En effet, ajoute-t-il, les événements de Chicago (1886-1887) « contribueront grandement à l’impopularité de plus en plus généralisée de la doctrine » quand bien même les exécutés étaient innocents.
Ce que semble surtout vouloir retenir Woodcock, c’est que « le mouvement anarchiste a complètement échoué dans sa tentative de gagner les travailleurs industriels », ces derniers « lui tournaient le dos dès que les conditions de vie s’amélioraient ». Cependant, des succès étaient enregistrés quand les anarchistes appliquaient leurs idées « à des projets concrets et immédiats », quand « ils témoignent d’un militantisme pragmatique qui n’a que faire de la pureté du dogme ».
Aussi, c’est pareillement, dans cette perspective, que l’on retrouvera chez Tomás Ibáñez (Philosophie de l’anarchie, théories libertaires quotidiennes et ontologie, ACL, 2012, réédité en 2017), l’idée que l’anarchie est « un type d’être constitutivement changeant ». « Elle ne peut pas être elle-même si elle ne varie pas. »
« Le déjà fait, l’acquis si l’on veut (histoire, expérience, écrits, etc.), ferme plus de voies de développement qu’il n’en ouvre, et immobilise plus qu’il n’impulse et qu’il ne dynamise. »
Tomás Ibáñez note encore, au cours des années autour de Mai 68, « la très forte expansion de l’anarchisme en dehors des frontières du mouvement », hors les murs des organisations. Néanmoins, il ne va pas si loin que Woodcock dans l’« anarcho-pacifisme » ou l’« anarchisme non-violent » ; sans doute le poids de la révolution de 36 est-il encore bien pesant sur ses épaules - à notre étonnement, sans doute, chez cet esprit antidogmatique.
Maintenant, avec cette orientation que nous voulions éclairer, on ne peut que conseiller la lecture des Avatars de l’anarchisme, thèse de Michel Froidevaux, à l’Atelier de création libertaire.
André Bernard
Simone Weil, Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale, suivi de Transposer la pensée de Simone Weil par Robert Chenavier. Libertalia, 2022, 348 P.
Brillante agrégée de philosophie à 22 ans en 1931, Simone Weil est très vite éveillée aux questions politiques et sociales. Elle est attirée par le syndicalisme révolutionnaire, dont elle retient l’idée d’auto-émancipation de la classe ouvrière rendue à sa dignité - l’organisation syndicale étant conçue comme un élément essentiel de la lutte des classes -, collaborant à L’École Émancipée et à La Révolution Prolétarienne de Pierre Monatte. Sa dénonciation du devenir réel du communisme soviétique va ensuite la rapprocher de Boris Souvarine, rencontré par l’intermédiaire de l’anarcho-syndicaliste Nicolas Lazarévitch, lequel a connu de l’intérieur le « paradis des travailleurs ». Elle va adhérer en 1932 à son Cercle Communiste Démocratique et participer à l’aventure éditoriale de sa revue créée l’année précédente, la Critique Sociale.
Poussant son analyse, elle va détecter dans toutes les grandes puissances industrielles, y compris l’Union Soviétique, une tendance à la spécialisation dans un but productiviste, conduisant à la formation d’une caste bureaucratique. Ce sont les prolégomènes de ses Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale, écrites en 1934 - année qui a vu vaciller la République française sous les coups de boutoir des ligues d’extrême-droite factieuses lors de leur tentative insurrectionnelle du 6 février - et qui devaient paraître dans la Critique Sociale, mais l’article initial est devenu un manuscrit de 120 pages bien serrées et la revue venait juste de cesser de toute façon sa parution, faute de fonds suffisants. 1934, c’est une période où tout ce qui semble normalement constituer une raison de vivre s’évanouit et où l’on doit, sous peine de sombrer dans le désarroi ou l’inconscience, tout remettre en question.
Elle dénonce les progrès de la technique et la production en série :
ils réduisent de plus en plus les ouvriers à un rôle passif ; ils en arrivent, dans une proportion croissante et dans une mesure de plus en plus grande, à une forme de travail qui leur permet d’accomplir les gestes nécessaires sans en concevoir le rapport avec le résultat final.
Il convient donc de réorienter la production pour qu’elle soit adaptée à sa fin nouvelle, à savoir le bien-être du commun d’hommes que l’alliance de la pensée et de l’action va rendre libres et égaux : c’est ce qui sera mis en œuvre, ou à tout le moins tenté, deux ans plus tard en Espagne lors du bref été de l’anarchie, qu’a connu d’ailleurs Simone Weil, pendant une durée de temps certes limitée, lorsqu’elle rejoignit la colonne Durruti sur le front d’Aragon.
Jean-Jacques Gandini
Reiner Schürmann, Se constituer soi-même comme sujet anarchique, Diaphanes. Collection Anarchies. Zürich, Paris, Berlin, 2021, 127 P.
À l’inverse des textes parfois franchement imbuvables qu’il a commis, notamment son délirant dialogue avec Nika Dubrovsky, compagne de feu David Graeber, il faut dire de Mehdi Belhaj Kacem, qui préface ce livre, que pour cette fois-ci il est aussi clair que le permet la complexité du sujet abordé, à savoir le sabotage de la métaphysique, poursuivi après bien d’autres, dont Heidegger, par le philosophe Reiner Schürmann.
Comme ce philosophe tôt disparu – puisqu’il mourut du sida en 1993 à l’âge de 52 ans – est peu connu dans nos milieux, il n’est certainement pas inutile d’en dire ici quelques mots. Né à Amsterdam de parents allemands, c’est en français qu’il écrivit ses principaux textes, même si à partir de 1971 il vécut aux États-Unis où, chaperonné par Hanna Arendt, il fut recruté par le Département de Philosophie de la prestigieuse New School for Social Research de New York dont il assuma plus tard la direction départementale. Prêtre dominicain pendant cinq ans, il se défroqua en 1975.
Revenant maintenant à ce livre, je ne commenterai ici que le premier des trois essais assez courts dont il se compose. Les deux autres, Que faire de la métaphysique ? et Des doubles contraintes normatives, se trouvent en connexion directe avec les deux principaux ouvrages de Schürmann, Le principe d’anarchie (Paris, Seuil, 1982) et Les hégémonies brisées (Zurich-Berlin, Diaphanes, 2017). Ils ne sauraient dispenser de lire ces deux ouvrages qui à mon sens sont tout à fait incontournables, surtout le premier, et dont le compte rendu réclamerait énormément plus que les quelques lignes qui pourraient leur être consacrées ici.
Le premier essai, publié originalement sous le titre « On Constituting Oneself as an Anarchistic Subject » dans la revue Praxis International, vol. 6, n° 3, en 1986, donne son titre au livre. Il est regrettable que les nuances que permet la langue anglaise entre « anarchy », « anarchism », « anarchist », « anarchic » et « anarchistic » ne puissent être rendues en français qui ne dispose que d’ « anarchie », « anarchiste », « anarchisme » et « anarchique » pour couvrir le même champ sémantique, car « anarchistic » n’est pas la même chose que le français « anarchique » pour lequel l’anglais dispose du terme « anarchic ».
Ce commentaire lexical qui peut paraître oiseux, il l’est un peu moins dès que l’on s’aperçoit qu’il touche directement au clivage strict, et pour certains d’entre nous insoutenable dans sa radicalité, entre l’anarchie et l’anarchisme qui hante certains des textes qui ont circulé parmi nous ces derniers temps et auxquels quelques articles de notre dossier font référence. Il est vrai que Schürmann lui-même insiste pour différencier le concept d’anarchie auquel il se réfère de l’anarchisme porté par le mouvement anarchiste ; cependant, si l’essai recueilli dans ce livre est intéressant, c’est en bonne mesure parce qu’il laisse entrevoir l’attrait envers l’anarchisme que, probablement sous l’influence de ses lectures de Foucault, Schürmann éprouvait chaque fois plus clairement. Il n’est que de lire les dernières pages de cet essai pour s’en convaincre, j’en cite des extraits : « Contester des effets de pouvoir en tant que tels… consiste à intervenir contre toute nouvelle figure de domination… », ou encore : « Le sujet anarchique se constitue lui-même à travers des micro-interventions dirigées contre les configurations récurrentes de sujétion et d’objectivation », ou enfin « Pour une culture obsédée par ce qui se loge au plus profond du sujet… la constitution anarchique de soi signifie que la réflexion visant le dedans se disperse en autant de réflexes visant le dehors qu’il y a des systèmes de pouvoir à court circuiter, à disqualifier et à dérégler. » Beau programme que ne renierait aucun, aucune, anarchiste luttant au sein d’un mouvement anarchiste.
Tomás Ibañez
Thom Holterman, Anthropologie et anarchie dans les sociétés polycéphales, Lyon, Atelier de création libertaire, 2021, 144 P.
Clastres, Graeber, Scott, Macdonald, d’autres encore… et Amborn, car il est de plus en plus évident que l’anthropologie est devenue une discipline scientifique mieux adaptée à la théorie anarchiste que la sociologie ou la science historique.
Hermann Amborn, né en 1933, est un anthropologue allemand que nous fait découvrir Thom Holterman qui s’appuie sur ses travaux pour développer l’idée que l’évolution des sociétés ne conduit pas inéluctablement à l’instauration de l’État ; il en est de même pour les rapports inégalitaires entre les êtres humains ; en bref, que la société existante n’est pas immuable. Il a existé, et il existe, des sociétés où les rapports sociaux étaient, et sont, égalitaires (Voir Zomia de J. C. Scott et les « zones sans souveraineté »).
Rappelons que Thom Holterman est docteur en droit, qu’il fut objecteur de conscience et fondateur du groupe provo de Rotterdam ; de quoi éveiller notre intérêt et notre curiosité quand il nous propose sa lecture anthropologique de l’anarchisme.
Dans un premier temps, il avait écrit un commentaire d’un livre d’Amborn, texte qu’il a voulu par la suite approfondir pour élargir sa connaissance vers les possibilités d’une « anarchie régulée » et d’une « société sans État ». Dans son Anthropologie et anarchie, il va cependant commencer par citer Blankertz et Goodman : « La colonne vertébrale d’une société est son autonomie juridique ; le droit est formé par la tradition et les contrats au sein des groupes sociaux et entre ceux-ci. » Et puis il nommera ensuite Pierre Clastres, Marshall Sahlins, Marcel Mauss, Élie Reclus, James C. Scott et bien d’autres. « Les connaissances alors obtenues inciteront à reconsidérer la question, même si elles ne peuvent être appliquées directement dans les situations étatistes occidentales. »
Par ailleurs, Holterman retient de ses lectures que « la situation présente, autoritaire, du droit pénal occidental est directement liée à toutes ces autres positions autoritaires de la société occidentale. Leur objectif commun ? Garantir le maintien du lien entre le pouvoir et la propriété privée, ce lien qui crée des inégalités socio-économiques fondamentales ».
La nécessité d’un pouvoir central n’est pas indispensable pour une paix sociale durable ; le besoin de l’État n’est pas essentiel ; « l’absence d’État n’est pas un vilain défaut » ; c’est une notion occidentale relativement récente (XVe et XVIe siècles) développée, d’un côté, sous la Renaissance italienne, par la force politique du moment qui organisait autour de la notion de lo stato le contrôle d’un territoire après avoir confisqué le pouvoir à son seul bénéfice ; de l’autre, une notion argumentée par deux philosophes politiques, le Français Jean Bodin et l’Anglais Thomas Hobbes, qui pensaient qu’une autorité forte ramènerait la paix et le calme dans les sociétés de l’époque où sévissaient des guerres incessantes :
L’État était vu comme un moyen de bloquer la violence dans la société. Il fallait donc qu’il en accapare le monopole, afin de créer une société harmonieuse.
Si le concept a pris un caractère quasiment universel, pour autant, son efficacité n’est pas constatée si l’on considère la perpétuation des guerres. Encore aujourd’hui, de nombreuses sociétés s’efforcent de résister, ou de se passer complètement – sinon de s’accommoder – des structures étatiques ; cette résistance est relativement passée sous silence par les historiens.
Si, dans toute société, on ne peut nier l’existence de relations de pouvoir, il s’agit d’empêcher la création d’un monopole du pouvoir ; il s’agit de rechercher des formes d’ordre sans pouvoir central imposé ; il s’agit de créer des « relations indépendantes de la domination et de la violence » ; il s’agit de distinguer entre le « pouvoir coercitif vertical » et le « pouvoir non coercitif fondé sur le consensus ».
C’est ce que décrivent certains anthropologues comme Evans-Pritchard et Amborn quand ils parlent de sociétés acéphales ou polycéphales, de sociétés segmentées, horizontales, de droit coutumier, d’« anarchie régulée » ou « ordonnée », autrement dit quand ils arpentent un champ sémantique libertaire. Ce qui n’empêche pas, dans ces sociétés, le développement d’une certaine hiérarchie – « L’abus de pouvoir n’est-il pas de tous les temps et de quasiment de tous les lieux ? » –, hiérarchie qui s’installe par la notabilité, la personnalité, la gérontocratie, le savoir, l’expérience, l’acte héroïque, etc. Mais une hiérarchie qui n’oblige personne à obéir et dont « l’autorité n’est jamais donnée pour acquise ».
Il est reconnu que « la communauté a besoin de personnalités engagées, actives, créatives (mais généralement ambitieuses), et en même temps, elle doit les empêcher d’exploiter leur potentiel de pouvoir pour leur propre bénéfice ».
(Quant à la situation féminine, il est noté que « ces sociétés ne connaissent à peu près jamais l’égalité de genre ».)
Si la pensée occidentale a inventé l’État, elle a élaboré tout autant le ius resistendi, le droit de résistance qui va jusqu’au tyrannicide. Thom Holterman note également que, pour « éviter le pouvoir d’État, voire s’en retirer », la résistance peut se construire en rhizomes, en réseaux, qui peuvent aussi conduire, et c’est regrettable, à « une concentration d’influence », déclenchant « nombre d’institutions mises en place […] axées sur l’action quotidienne et [qui] visent à la contrecarrer si elle devient dominatrice ».
« Amborn estime que le droit a un caractère ambivalent : selon les sociétés dans lesquelles on l’étudie, il sert soit à former et à stabiliser les rapports de force, soit – et c’est essentiel – précisément à limiter l’accumulation du pouvoir. »
À noter, dans notre société actuelle, la reconnaissance des « droits de l’Homme », plus théorique que réelle, car très souvent « l’État de droit plie le genou devant la raison d’État ».
« La pensée occidentale en matière de droit est infectée par la pensée chrétienne », écrit Holterman, une pensée qui a imposé ses « grandes apparences transcendantes » : Dieu, le roi, l’État et le gouvernement, pensée qui a disqualifié, en les colonisant, le droit des autochtones. Pensée chrétienne que l’on pourra cependant nuancer avec son fond de survivance païenne.
Si la jurisprudence occidentale s’appuie sur des textes qui, à la longue, se pétrifient et se fossilisent, les sociétés polycéphales ont à leur disposition un « réservoir d’outils intellectuels, de moyens de réflexions souples » que sont les proverbes, les anecdotes, les allégories, les traditions historiques, soit une base commune, « accessible et compréhensible par tout un chacun », cela sans prétendre à l’universalité, règles de droit créées collectivement et qui « tiennent plus de la ligne directrice que de l’impératif ».
Pour les sociétés polycéphales, en matière de droit pénal, la plus grave des infractions consistait à négliger le devoir de solidarité. Pour le meurtrier, pas de prison ou de peine de mort, mais l’indemnisation, la compensation, le dédommagement, en vue d’une future réconciliation qui est plus importante que la réparation qui, elle, contient en fait une sorte de « pardon institutionnel ». La sanction la plus dure étant l’expulsion : la mise au ban.
Dans ces sociétés sans pouvoir institutionnalisé, mais avec toujours pour but la paix sociale, le conflit ne peut se résoudre sans la recherche d’un consensus, sans gagnants ni perdants, sans recours ni à la violence physique ni à une institution exécutante. Référence est faite au philosophe ghanéen Kwasi Wiredu qui « a construit, à partir d’exemples africains, sa théorie de l’éthique du consensus, et l’a liée au plaidoyer pour une politique sans partis politiques ». Une traduction ne pourrait qu’enrichir la pensée libertaire.
Alors que les anarchistes conçoivent une société sans État comme seulement un « possible », les ethnologues décrivent un « pouvoir non coercitif fondé sur le consensus », de facto, qui s’ouvre sur une société de droit sans pouvoir institutionnalisé. En l’état, ce modèle est sans aucun doute inapplicable à nos sociétés occidentales, mais il peut sans doute nous apprendre, nous permettre, à penser en termes nouveaux, à changer de paradigme.
C’est David Graeber qui décrit un « communisme de base », un « communisme quotidien », c’est-à-dire un ensemble de structures psychologiques, morales et culturelles qui n’obéissent pas à un calcul froid d’intérêt personnel, au « donnant-donnant » ; et c’est lors de catastrophes (inondations, pannes diverses, tremblements de terre, désastre économique, etc.) que, spontanément, la place est faite à la solidarité, à la générosité, au don de soi, à la coopération bénévole : fondements de la sociabilité humaine.
Le changement climatique en cours va provoquer à n’en pas douter un certain nombre de catastrophes, par divers effondrements, et des vides étatiques et économiques qui pourraient amener ce changement de paradigme qui ouvre l’horizon.
Qu’advienne donc cette catastrophe et qu’elle soit bénéfique !
André Bernard
Richard Gombin, Le gauchisme, origines et perspectives, Spartacus, 2018, 166 P.
C’est d’abord en 1971 que ce livre est paru, et qu’il a connu un rapide succès. Sa réédition récente, complétée par trois commentateurs, fait écho aux préoccupations de ce numéro de Réfractions et enrichit les récits et témoignages qui y sont recueillis. Dans la décrépitude générale des partis de la gauche institutionnelle et parlementaire, il offre toujours des outils et des références utiles.
Michel Froidevaux, Les avatars de l’anarchisme, La révolution et la guerre civile en Catalogne (1936-1939) vues au travers de la presse libertaire, Lyon, Atelier de création libertaire, 2022, 752 P.
L’anarchisme se trouverait-il condamné à être éternellement oppositionnel sans parvenir, non pas, bien sûr, à imposer, mais à implanter son projet de société? Faut-il penser que les idées libertaires se confineraient surtout à la formulation de critiques aiguës contre la tragique comédie du pouvoir? Les influences exercées par le courant antiautoritaire seraient-elles surtout secondaires? L’anarchisme se limiterait-il seulement à n’être que philosophie et éthique personnelles?
Le cas de la révolution espagnole (1936-1939) permet, en partie, d’avoir des réponses à ces interrogations. C’est ce que nous pouvons constater à la lecture du texte de Michel Froidevaux (1951-2020) et ses recherches réalisées à partir de l’analyse de plus de 130 périodiques libertaires de l’époque, concernant de nombreux thèmes de la vie de tous les jours, tels que les usines, les écoles, les quartiers, chez les coiffeurs et les barbiers, la création artistique, les spectacles, la sexualité, la corrida, le sport, l’aide sociale, etc. Analyses qui vont au-delà de la doxa rouge et noire et qui nous invitent à regarder l’avatar de l’anarchisme à partir de cet exemple historique unique. Celui-ci nous ramène concrètement à penser et vivre nos propres perspectives utopistes accompagnées par un engagement pragmatique où l’on retrouve une démarche commune entre politique et culture libertaire.
Florian Eitel, Le Vallon horloger et ses anarchistes, une micro-histoire de Saint-Imier et de Sonvilier aux débuts de la mondialisation ; traduit de l’allemand et adapté par Marianne Enckell et l’auteur. Bienne (Suisse), revue Intervalles 123, 2022, 240 P.
Les villages de Saint-Imier et Sonvilier sont en pleine transformation dans le dernier tiers du XIXe siècle. Le train arrive en 1874, le marché des montres est confronté à la concurrence américaine, les machines modifient les conditions du travail à domicile traditionnel, les ouvriers s’associent. Le Vallon de Saint-Imier devient un vivier de militants anarchistes, un laboratoire du fédéralisme. Pendant une dizaine d’années s’y développent des sociétés de résistance, des mutuelles, des pratiques culturelles originales, en rupture avec le Parti libéral-radical. Avec les limites que l’on peut imaginer : l’organisation se borne pratiquement aux ouvriers horlogers sans inclure les autres métiers, les femmes y ont peu de place et de visibilité.
Ce récit raconte leur représentation de la révolution sociale et du monde nouveau. La commune sera la cellule de base de la fédération universelle ; la Commune de Paris a montré l’exemple.
Sylvain Boulouque, Le peuple du drapeau noir, une histoire des anarchistes. Atlande, 2022, 244 P.
« Autrement dit des anarchistes en France aux XXe et XXIe siècles », précise l’auteur, même si le XIXe est plus présent que le nôtre et qu’on rencontre quelques « étrangers » dans ces brefs chapitres.
« Éditeur de référence », « leader de la préparation des concours », Atlande ne connaît hélas pas l’usage de la ponctuation ni des guillemets français, laisse nombre de coquilles bénignes mais gênantes à la lecture, écorche les noms de ses confrères ; éditeur et auteur ont omis de demander une relecture à un·e historien·ne compétent·e. Il en résulte malheureusement un ouvrage approximatif où l’on voit passer quantité de noms de personnes et d’organisations et quelques idées générales, sans guère transmettre l’enthousiasme juvénile que rappelle l’auteur.
Phil Casoar, L’Arsène Lupin des galetas : la vie fantasque de Raoul Saccorotti, cambrioleur anar en gants blancs. Éd. du Cerf, 2022, 562 P.
« Un parcours de monte-en-l’air aux mille visages. Un compagnonnage avec les antifascistes en exil. Une cavale héroïque, les flics de France et les espions mussoliniens aux trousses […]. Des bas-fonds de Gênes aux cimes des Alpes, des ruelles de Ménilmontant aux ramblas de Barcelone, des cachots de prison aux camps d’internement, sans oublier la colonie de confinement des îles Tremiti, Phil Casoar refait le chemin qui va de la Belle Époque à la Guerre froide, retrouve la trace et la vérité du plus anar des gentlemen cambrioleurs, ainsi que des ouvriers italiens et des aristocrates russes qui l’ont aimé. » On y voit notamment passer, entre Grenoble, Genève et Barcelone, Louis Mercier, Lucien Tronchet, Edmond Deturche et des armes pour l’Espagne révolutionnaire.
Thinking as anarchists : selected writings from Volontà, edited by Giovanna Gioli and Hamish Kalin, Édimbourg : Edinburgh University Press, 2022, 278 P.
Avec des textes d’Amedeo Bertolo, Tomás Ibañez, Eduardo Colombo, Luciano Lanza, Rossella Di Leo, Nico Berti, Francesco Codello, pour la plupart publiés dans la revue italienne Volontà dans les vingt dernières années du siècle dernier ; préface de John Clark, riche introduction des éditeurs. Révision et compléments au recueil éponyme pubié à Milan en 1986, dans une première traduction d’April Retter. Illustrations, notices biographiques, index.
Nicolas Bonanni, Que défaire ? : Pour retrouver des perspectives révolutionnaires. Grenoble, Le Monde à l'envers, 2022, 101 P.
Les luttes contemporaines sont souvent cantonnées à des résistances contre le libéralisme triomphant et l'extrême-droite carnassière, avec une efficacité pour le moins relative. Pour contribuer à sortir de cette position défensive, pour retrouver des perspectives, ce petit livre s'attaque à deux totems de la gauche : la fascination pour la technologie et la centralité de l’État et des élections. Appuyé tant sur des exemples actuels que sur l'histoire et les théories du mouvement révolutionnaire, il invite les anticapitalistes à questionner une partie de leur héritage, et à cette fin convoque tour à tour les pensées de Günther Anders, Simone Weil, Cornelius Castoriadis, Ivan Illich, Gustav Landauer, John Holloway, Matthew B. Crawford…
Quelques revues et publications en vrac
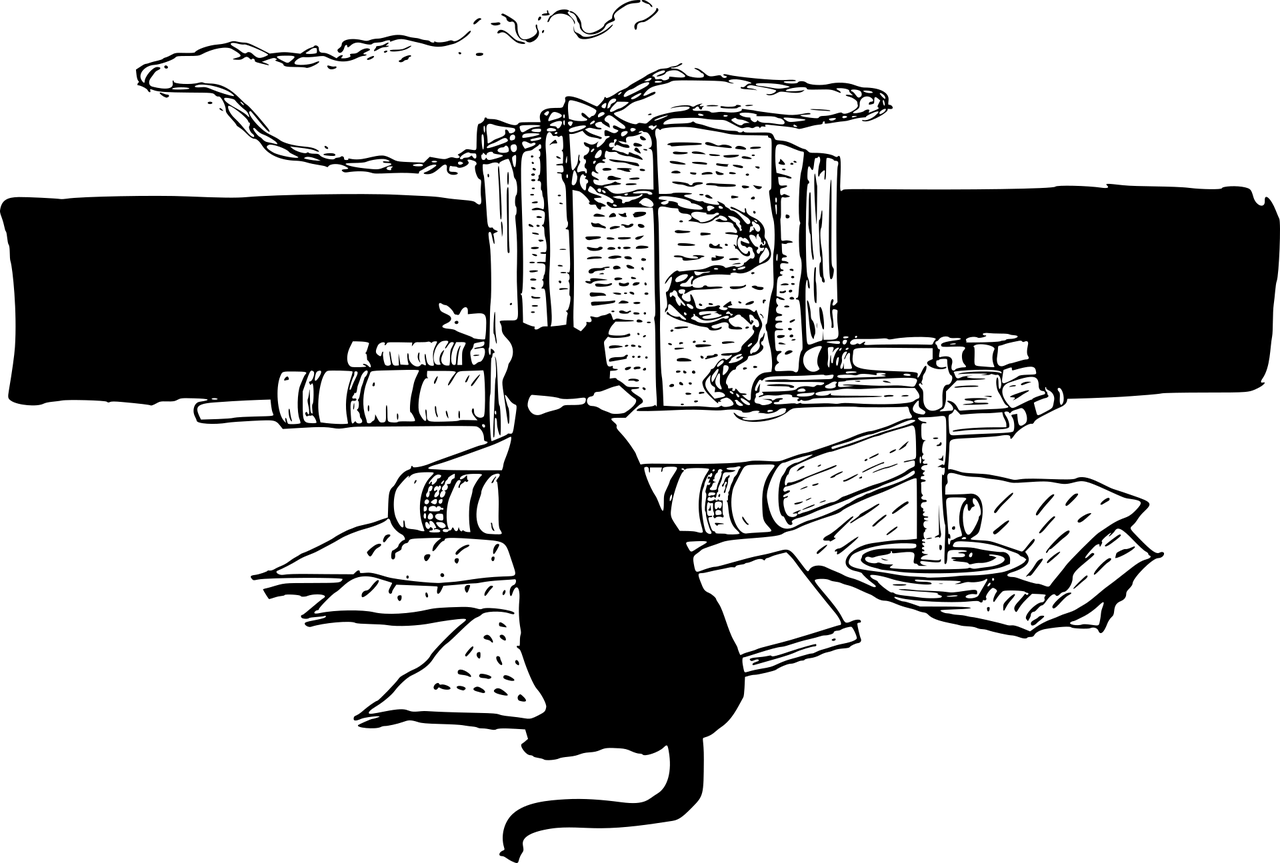
• Les éditions Chandeigne publient treize témoignages de réfractaires – dont celui de Jorge Valadas (voir dans ce numéro son dialogue avec JJ Gandini) – ayant fui la dictature de Salazar dans les années 1960 pour échapper à l’enrôlement dans les guerres coloniales : Exils, Témoignages d’Exilés et de Déserteurs Portugais 1961-1974 ; préface de Victor Pereira ; Chandeigne, Bibliothèque Lusitane, 2022, 156 P.
• Nous avons reçu la belle revue Alcheringa n° 2, été 2021, Le surréalisme aujourd’hui, qui nous rappelle que le surréalisme est plus actuel que jamais, car il est « le seul égrégore spirituel, de dimension internationale, qui opère la plus ample et cohérente recollection de tout le passé subversif de l’humanité ». Une belle iconographie et des poèmes complètent heureusement un ensemble de textes. Le numéro 3 est paru en septembre 2022 : Ni commencement, ni commandement, juste un rêve.
• Revue Esprit, juin 2022 : La démocratie des communs. Les « communs », dans leur dimension théorique et pratique, sont devenus une notion incontournable pour concevoir des alternatives à l’exclusion propriétaire et étatique. Opposés à la privatisation de certaines ressources considérées comme collectives, ceux qui défendent leur emploi ne se positionnent pas pour autant en faveur d’un retour à la propriété publique, mais proposent de repenser la notion d’intérêt général sous l’angle de l’autogouvernement et de la coopération. Ce faisant, ils espèrent dépasser certaines apories relatives à la logique propriétaire (définie non plus comme le droit absolu d’une personne sur une chose, mais comme un faisceau de droits), et concevoir des formes de démocratisation de l’économie. Le dossier de ce numéro, coordonné par Édouard Jourdain, tâchera de montrer qu’une approche par les communs de la démocratie serait susceptible d’en renouveler à la fois la théorie et la pratique, en dépassant les clivages traditionnels du public et du privé, ou de l’État et de la société.
• Tomás Ibañez publie ses Derniers fragments épars pour un anarchisme sans dogmes, Rue des cascades, 2022, 317 P. Derniers en date, écrit l’auteur, mais « pas les derniers de mon existence »… Un recueil d’articles dont plusieurs ont paru dans Réfractions.
• Pierre Kropotkine, La Conquête du pain, préface d'Élisée Reclus, avant-propos de Renaud Garcia. Paris, Nada, 2022, 266 P. Belle réédition de cet ouvrage publié pour la première fois en 1892.
Que tout soit à tous, en réalité comme en principe, et qu’enfin dans l’histoire il se produise une révolution qui songe aux besoins du peuple avant de lui faire la leçon sur ses devoirs.
