Comment j’ai failli devenir anarchiste
Comment j’ai failli devenir anarchiste
Larry Cohen
Monique Rouillé-Boireau m’a demandé d’expliquer, dans la mesure du possible, pourquoi j’avais choisi il y a fort longtemps de ne pas me revendiquer de l’anarchisme, en dépit d’une proximité idéologique et humaine évidente. Cette demande m’a donc poussé à remonter à mes premiers pas dans le militantisme, que je situerais vers 1972 quand j’étais encore étudiant aux États-Unis.
D’abord un mot sur mon « pedigree ». Mon grand-père paternel avait été arrêté à Bialystok comme meneur de grève, envoyé en Sibérie, puis, après son évasion, avait retraversé toute la Russie et opté pour une sorte de clandestinité. Ayant l’Okhrana tsariste à ses trousses, il était parti à contrecœur pour l’Amérique après un bref séjour à Paris où il avait travaillé dans la confection. Mes parents, eux, avaient moins la fibre militante mais étaient restés bien à gauche (au point de voter pour les trotskistes pendant les années les plus sinistres de la guerre froide…). Mon enfance à moi, passée dans une banlieue résidentielle, était placée sous le signe du mouvement pour les droits civiques et de la mobilisation contre la guerre du Vietnam, à laquelle j’ai participé sans trop m’y engager. Si j’attire l’attention sur ces antécédents, c’est pour montrer que, tout en me targuant d’être en rupture, je m’inscrivais en réalité dans une certaine continuité familiale, une certaine fidélité à la tradition.
Mon arrivée à l’université du Michigan a coïncidé avec l’effondrement du mouvement étudiant, passé en quelques mois d’un pic, avec le massacre de quatre étudiants à l’université de Kent State au cours d’une forte mobilisation contre l’invasion américaine du Cambodge (suivi de peu par la tuerie de deux jeunes noirs à l’université de Jackson State), à un état proche de l’inexistence. Si bien qu’à l’automne 1970 il ne restait plus que quelques maos et trotskistes occupés surtout à s’implanter dans l’industrie automobile (nous étions tout près de Detroit) où les révoltes de la base contre la bureaucratie syndicale et les grèves sauvages étaient fréquentes.
Le léninisme de ces gauchistes m’a tout de suite rebuté. D’une part, ils niaient ou minimisaient le désastre que représentaient les régimes staliniens. D’autre part, je les trouvais peu en phase avec la réalité américaine, profondément marquée par un certain esprit « libertaire » que je partageais et auquel je reviendrai par la suite1. Parallèlement, une prof de géographie dont j’ai oublié le nom m’avait fait grande impression en plaidant pour le dépassement de l’État-nation. Enfin, j’ai commencé à me documenter sur l’anarchisme et je suis vite tombé sur le livre de Gabriel et Daniel Cohn-Bendit (Le gauchisme, remède à la maladie sénile du communisme) et les écrits de Daniel Guérin.
Or, s’ils se disaient libertaires et revendiquaient l’héritage de la Makhnovtchina et des anarchistes espagnols, leurs analyses me semblaient s’appuyer bien davantage sur Marx et, dans le cas des frères Cohn-Bendit, sur des groupes d’autres origines comme Socialisme ou Barbarie et les situationnistes. Qui plus est, la découverte des auteurs anarchistes classiques m’a déçu quelque part, surtout après avoir lu Marx, Luxemburg, Lukács, Korsch, Gramsci et d’autres. Bien sûr, il y avait aussi Murray Bookchin dont les écrits m’ont bien plu, mais je ne me sentais pas tout à fait sur la même longueur d’onde que lui.
Par ailleurs, les quelques anarchistes américains que j’ai pu rencontrer à l’époque m’ont donné plutôt envie de fuir : refus quasi puéril de l’autorité (voire du moindre effort de coordination), glorification de gestes et de comportements prétendument exemplaires, célébration de la légende espagnole, soutien peu critique à tous ceux qui, dans le monde entier, se réclament de l’anarchisme, et peu importe leur faiblesse numérique ou théorique. Pour tout dire, je les soupçonnais de se complaire dans une révolte « hors sol », c’est-à-dire essentiellement morale ou spirituelle, mais sans la moindre chance de transformer la société américaine. Peu intéressés par l’évolution du capitalisme ou la condition ouvrière (hormis les IWW, groupe hélas tourné davantage vers le passé que vers le présent), ils apparaissaient comme le produit d’une société très riche (il n’est pas inutile de rappeler ici l’écart de niveau de vie encore considérable, dans les années 1970, entre les États-Unis et l’Europe), et donc parfaitement en mesure de tolérer, de neutraliser, voire de profiter de courants rebelles. Bref, sur fond de bouleversements technologiques, de consommation de masse et de publicité omniprésente, on pouvait proclamer son anti-autoritarisme à peu de frais. Je me dois de reconnaître que j’étais moi aussi le produit de cette nouvelle configuration2.
À cela s’ajoute l’esprit libertaire évoqué plus haut. Si beaucoup d’Américains manifestent une quasi-vénération pour leurs institutions et surtout leur constitution, il y a aussi une tradition bien ancrée de méfiance à l’égard du pouvoir central (vite soupçonné de tyrannie) qui remonte à la guerre d’indépendance et peut-être encore plus loin. En effet, les racines protestantes du pays, l’absence relative de l’État dans les régions reculées pendant des périodes assez longues et l’adoption, dès la période coloniale, de formes d’autogouvernement local ont créé une société échappant en partie à la « verticalité » typique de l’Europe catholique, de l’Allemagne ou même de l’Angleterre, avec sa monarchie, ses lords et son Église anglicane. C’est très clairement contre cet univers vertical que les mouvements de contestation se sont dressés en Europe.
Pourtant, le caractère plus horizontal et moins visiblement hiérarchique de la société américaine n’est pas synonyme d’émancipation, tant s’en faut. Il génère au contraire des formes d’oppression spécifiques qui ont historiquement donné du fil à retordre aux marxistes comme aux anarchistes3. Pour être plus précis, les normes sociales y sont souvent imposées moins par une quelconque institution en surplomb que par la communauté immédiate. D’où le problème actuel d’un « petit peuple » alimentant le mouvement anti-avortement, qu’une certaine gauche s’escrime à expliquer par la seule force de la propagande4.
Un facteur clé dans ce contexte est l’absence d’un passé féodal sur le sol américain et la large acceptation du capitalisme comme allant de soi, avec son lot de gagnants et surtout de perdants. Cette mentalité s’accompagne d’une tendance à tout réduire à une affaire de volonté individuelle et donc à négliger la prégnance des phénomènes collectifs et plus « objectifs »… à l’exception de la stratification sociale et des discriminations (thème de prédilection aujourd’hui). Tout cela mis bout à bout permet aussi de mieux comprendre la puissance aux États-Unis du courant libertarien, terme que l’on pourrait utilement remplacer par celui d’anarcho-capitalisme. Pour ses partisans, l’État se résume en gros à une structure largement inutile qui empêche les individus de réaliser tout leur potentiel. Et ils sont loin d’être les seuls à défendre une vision aussi simpliste5.
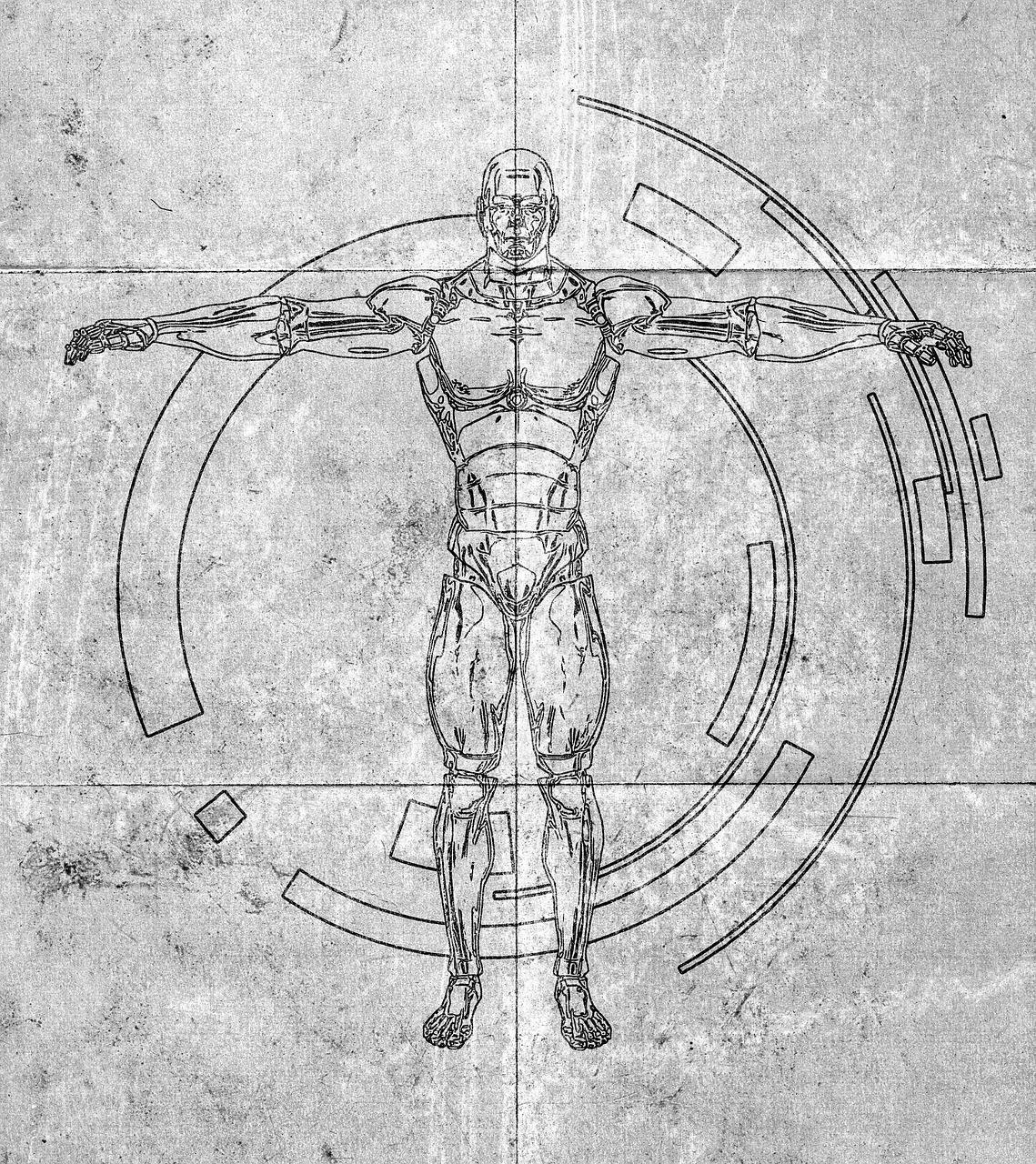
Certes, nous ne sommes pas responsables du détournement ou de l’utilisation brouillonne, par d’autres, des termes qui ont un sens pour nous. Il est vrai aussi que j’ai pu par la suite faire la connaissance en Europe d’anarchistes avec qui je me suis tout de suite senti sur la même longueur d’onde. Mais, jeune militant vivant encore aux États-Unis, je n’avais tout simplement pas envie de passer mon temps à répéter qu’il ne fallait me confondre ni avec les anarcho-capitalistes ni avec les anarcho-désobéissants « de gauche ». Ni d’ailleurs avec les marxistes, dont le côté doctrinaire me gênait profondément.
Comment se situer dès lors ? Si j’ai bonne mémoire, c’est grâce au livre des frères Cohn-Bendit que j’ai découvert Socialisme ou Barbarie, dont bon nombre des textes avaient été traduits en anglais et diffusés par le groupe britannique Solidarity. C’est celui-ci (et, à un degré moindre, Daniel Guérin) qui m’a fourni une désignation plus facile à porter : socialiste ou communiste libertaire. Ce courant, Castoriadis en tête, m’a par ailleurs aidé à garder une saine distance à l’égard du marxisme comme idéologie et m’a convaincu qu’on pouvait très bien se passer d’une chapelle ou d’une étiquette politiques (anarchisme, communisme de conseil, situationnisme, opéraïsme, ultragauche post-bordiguiste…). J’ai également constaté que des groupes d’origine anarchiste comme l’OCL en France ou la revue Collegamenti en Italie faisaient très largement référence à ce même héritage, Proudhon, Bakounine, Kropotkine et bien d’autres ayant été discrètement relégués à une place moins en vue.
Au cours du demi-siècle qui a suivi, j’ai eu le temps de nuancer quelque peu mon adhésion à cet ensemble intellectuel hétérogène et, bien que cela déborde le cadre de ce petit texte, je ne peux résister à la tentation de m’interroger en conclusion sur l’actualité de deux termes qui font partie de notre héritage commun : libertaire et anti-autoritaire. Les groupes léninistes, bien connus autrefois pour leur apologie des régimes les plus despotiques, leurs manœuvres manipulatrices et, dans certains cas, leur brutalité physique à l’égard de ceux qui ne se soumettaient pas à leur ligne, n’ont plus le vent en poupe, c’est le moins qu’on puisse dire. Est-ce encore la peine d’insister sur notre opposition à une mentalité et à des pratiques liées surtout à une époque révolue ? De même, l’autoritarisme qui semblait omniprésent il y a cinquante ans, y compris dans les pays les plus avancés économiquement, s’est beaucoup atténué sous l’effet, d’une part, des mêmes forces identifiées plus haut dans le contexte américain et, d’autre part, de l’évolution technologique. Celle-ci permet dans certains cas de piloter les entreprises et d’autres institutions avec une moindre intervention des petits chefs qui faisaient autrefois régner la terreur mais qui ont été rendus partiellement superflus par les algorithmes et des rapports de pouvoir moins directs, où chacun est appelé à la collaboration, à l’investissement personnel et au travail d’équipe6. J’estime en tout cas que c’est seulement par la prise en compte de ces mutations et de cette complexité que nous pourrons reposer la question de l’émancipation collective avec la pertinence qu’exige la situation d’aujourd’hui.
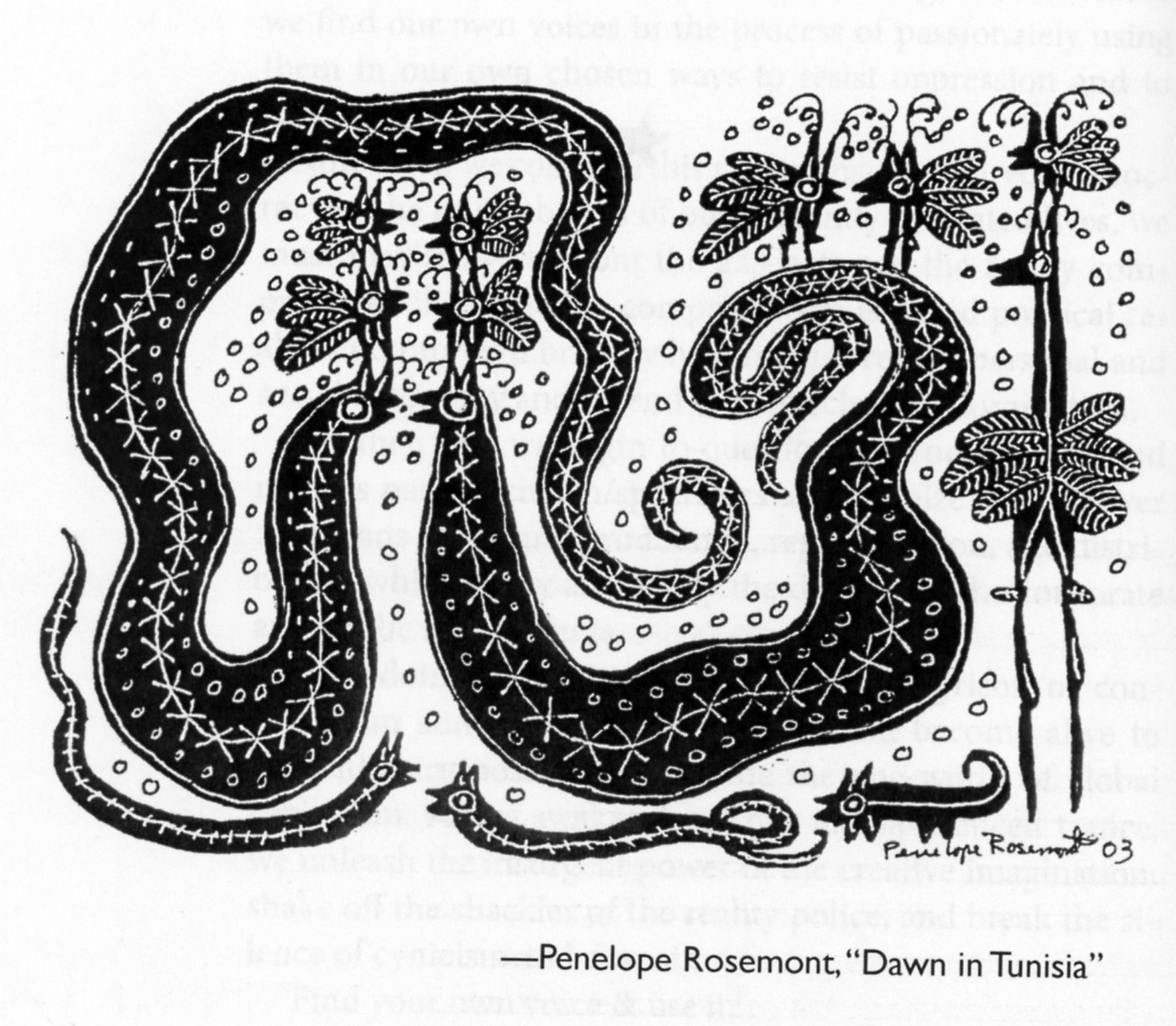
Anarchismes, Ultra-gauche et Conseillisme au tournant des années 1970 L’esprit libertaire des non-conformistes des années trente
