L’esprit libertaire des non-conformistes des années trente
L’esprit libertaire des non-conformistes des années trente
Édouard Jourdain
En guise de présentation du numéro n° 55 d’avril 1937 de la revue Esprit intitulé « Anarchie et personnalisme » figurent notamment les propos suivants1 :
les courants que nous étudions dans ce numéro sont beaucoup plus profonds, plus importants et plus riches que les associations trop pittoresques qu’évoque à l’ordinaire le mot d’anarchie. C’est toute une gamme d’attitudes humaines, dont Proudhon disait justement qu’elles constituent les trois quarts de la réalité sociale ; c’est, dans le mouvement ouvrier, une inspiration permanente, la plus proche sans doute de la nôtre, celle en tout cas qui lui offre le moins d’obstacles et le plus de prédispositions. En cette époque où la puissance, où l’"archie" brutale et arbitraire envahit et comprime la civilisation, on estimera l’intérêt qu’il y a à chercher tout ce qui pressent ou promet l’ordre de la personne.
L’ambition est annoncée d’emblée : mettre en évidence les affinités entre personnalisme et anarchisme.
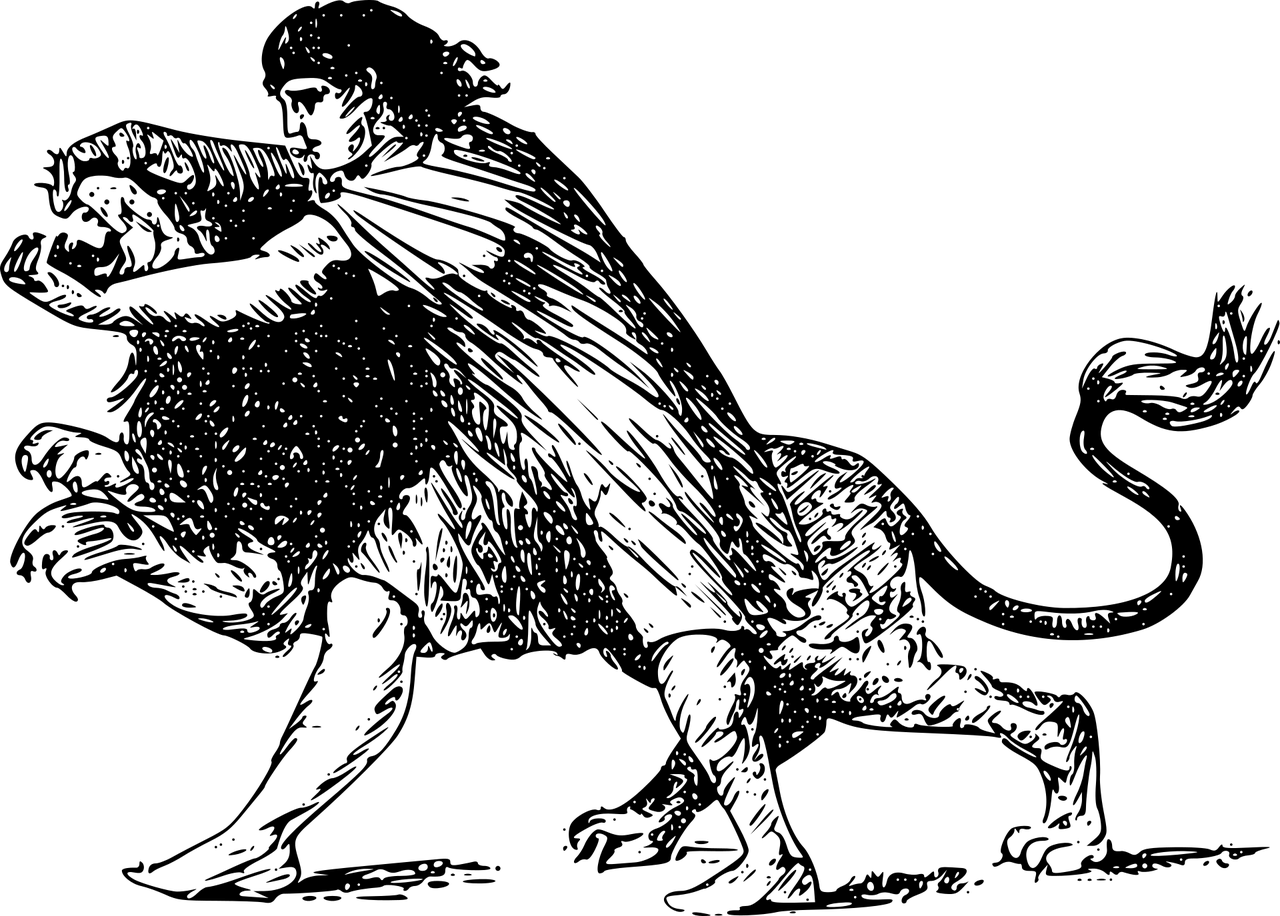
Ce numéro contient les articles suivants : « Proudhon, Bakounine et les réactions ouvrières des années soixante » par Georges Duveau, « Les initiateurs » par Max Boudin, « Méditations sur l’anarchie » par Victor Serge, « Documents relatifs à l’anarcho-syndicalisme en Catalogne et en Aragon » par Roger Labrousse, « Note sur le fédéralisme proudhonien » par Yves Simon, « Anarchie et avoir » par Maxime Chastaing, « L’anarchiste contre Dieu » par Paul-Louis Landsberg, « Pour rien au monde (anarchisme et catholicisme) » par José Bergamin et enfin « Le destin spirituel du mouvement ouvrier : anarchie et personnalisme » par Emmanuel Mounier » (qui sera repris dans le recueil Communisme, anarchie et personnalisme publié en 1966). On retiendra notamment de ce numéro les réflexions de Victor Serge sur l’anarchisme en forme de biographie, évoquant la révolte individualiste de la Belle époque et ses impasses, puis la révolution russe où il côtoie des anarchistes comme Apollon Kareline, membre de l’Exécutif Panrusse des soviets qui écrit le soir des pamphlets contre la peine de mort pendant que son collègue Dzerjinski, le président de la Tchéka, fusille à tout va. On notera aussi tout l’intérêt de l’article de Roger Labrousse qui rapporte en temps réel et avec enthousiasme les réalisations de la révolution anarchiste en Espagne en commentant des textes, pour la plupart juridiques concernant l’organisation fédérale, issus de Tierra y libertad, Solidaridad obrera ou encore le Journal de Barcelone. Mais c’est le dernier article d’Emmanuel Mounier, constituant un véritable essai (98 pages), qui retiendra le plus notre attention. On est frappé par sa large connaissance des écrits anarchistes, citant Proudhon, Bakounine ou Kropotkine mais aussi James Guillaume, Jean Grave ou Fernand Pelloutier en effectuant une lecture serrée de leurs œuvres. Il ne cache pas d’ailleurs sa sympathie envers l’anarchisme : « Je n’hésiterai pas à dire que pour nous personnalistes il est un des espoirs sur lequel nous misons pour l’avenir et le développement de ce mouvement2. »
C’est l’historien Jean-Louis Loubet Del Bayle qui a consacré le terme de « non-conformistes des années trente3» pour désigner un mouvement hétéroclite né comme son nom l’indique dans le tournant des années 1930, en France, dans un contexte historique propice au renouvellement de la pensée politique : la crise du capitalisme de 1929, la prise du pouvoir par les bolcheviks et l’avènement du fascisme sont autant d’évènements à partir desquels ces non-conformistes vont prendre des positions critiques vis-à-vis de l’État moderne, du libéralisme, du capitalisme, du marxisme ou encore du fascisme. Nous trouvons notamment au sein de ce mouvement deux groupes de pensée qui vont donner naissance à des revues du même nom : Ordre nouveau et Esprit. Ces deux groupes sont marqués respectivement par deux noms marquants : Alexandre Marc (1904-2000) et Emmanuel Mounier (1905-1950). Alexandre Marc quitte la Russie en 1918 et émigre avec ses parents en 1919 en France où il suit des études de philosophie et de sciences politiques. À l’origine avec Arnaud Dandieu et Robert Aron du groupe Ordre Nouveau, il a développé les notions de fédéralisme global ou intégral en se rattachant à l’œuvre de Proudhon et pris une part importante dans les débats concernant le fédéralisme européen. Emmanuel Mounier est le fondateur de la revue Esprit, qui existe toujours aujourd’hui. Inspiré par Bergson et Péguy, il passe l’agrégation de philosophie en 1927 et enseigne au lycée du Parc à Lyon pendant la seconde guerre mondiale avant de contribuer au rapprochement franco-allemand de 1945 à 1950. Il est le théoricien du personnalisme qui, fortement imprégné de la culture chrétienne, se veut élaborer une philosophie politique à hauteur d’homme contre tout système oppressif. Une coopération aura lieu dès ses origines entre les deux groupes de 1933 à 1938. Il existe cependant quelques éléments qui les distinguent : Ordre Nouveau est un peu plus radical qu’Esprit, avec des prises de position clairement révolutionnaires, d’autre part il se veut agnostique alors qu’Esprit assume une dimension chrétienne tout en étant ouvert ; enfin, en ce qui concerne le terme de démocratie, Esprit entend le réinvestir alors que pour Ordre Nouveau il est discrédité (dans une certaine mesure les mêmes tensions existent chez les anarchistes dans ce rapport à la démocratie).
Bien que ne se réclamant pas de l’anarchisme, ils vont souvent partager des idées communes avec ce mouvement, parfois même explicitement comme en témoigne la référence régulière à Proudhon dans la revue Ordre nouveau ou encore le dialogue explicite qu’a noué Emmanuel Mounier au sein d’Esprit notamment dans son essai Anarchie et personnalisme où il affirme notamment : « Trois notions me semblent exprimer ce que l’anarchisme a senti de plus profond sur l’homme : celles de dignité, de révolte, d’émancipation4. »
Nous retrouvons ainsi dans ce mouvement une critique commune à l’anarchisme de l’État, des totalitarismes et du capitalisme, assortie de propositions souvent plus modérées que celles des anarchistes, mais qui n’en reprennent pas moins les mêmes directions.
Critique de la statolâtrie
Il existe ainsi dans ce mouvement ce même souci de combattre pour la liberté humaine contre toute forme de pouvoir diminuant celle-ci. Comme le souligne Emmanuel Mounier :
Il restera toujours entre les pouvoirs, inévitablement tarés par l’ambition et le vertige de la puissance, d’une part, et toutes les activités qui sont touchées par la liberté spirituelle de l’homme, d’autre part, une tension irrésoluble, plus qu’une lutte de classes, une lutte d’ordres, au sens pascalien du mot5.
Le parti, relais d’un pouvoir abstrait qui, ne pouvant prendre en compte la multiplicité du réel, en vient à le simplifier par la coercition, fait ainsi l’objet d’une critique en règle visant aussi bien le système multipartite des démocraties libérales que les politiques du parti unique, communiste ou fasciste. Nous pouvons ainsi lire dans la revue Ordre Nouveau : « Ce que l’on appelle programme d’un parti n’est qu’une construction intellectualiste, abstraite, un ensemble arbitraire de revendications démagogiques conçues a priori, ou encore une utopie gratuite sans rapport avec le réel6. » La critique du parti et de l’État rejoint alors une critique libertaire de la démocratie libérale incapable de donner une réalité au sens du mot « liberté » :
Il n’y a pas de liberté véritable dans un régime où toutes les forces de suggestion de la presse, mises au service de l’argent et de l’État, privent la personne des fondements du jugement. Où la police cesse d’être un moyen d’ordre pour devenir un système de gouvernement. Où l’on a désappris à tout un peuple l’usage de la liberté politique en faussant même ce que le régime parlementaire, à son origine, pouvait avoir de valable. Il n’y a pas de fraternité dans un système qui, fondé ouvertement sur une frénésie de profit et de rivalités sordides, n’a plus d’autre moyen de gouverner que de dresser les diverses catégories de citoyens les unes contre les autres et d’exploiter, divisant pour régner, les pires sentiments de haine et d’envie7.
Il apparaît alors à l’époque clairement que le danger suprême est le culte d’un État censé pouvoir transformer le monde et la vie :
La statolâtrie apparaît comme l’expression la plus conséquente des erreurs contemporaines : c’est leur commun dénominateur. L’URSS du camarade Staline et la France de M. Lebrun, la Turquie « occidentalisée » et le IIIe Reich « en rupture d’Occident », le Duce et le président Roosevelt, tous sacrifient plus ou moins systématiquement au culte inhumain de l’État. Ce point a été suffisamment mis en lumière dans tous nos écrits antérieurs pour nous épargner l’obligation d’insister là-dessus8.
Alors que de nombreux intellectuels cèdent aux sirènes du fascisme, Alexandre Marc et René Dupuis, dans Jeune Europe, écrivent : « Le fascisme a prétendu libérer l’homme de l’esclavage du matérialisme, mais en faisant de l’État l’expression suprême de la vie matérielle et spirituelle de la nation, il réduit en fin de compte le spiritualisme qu’il prétendait incarner à un matérialisme détourné car la statolâtrie, sous la forme absolue qu’il lui donne, n’est autre que la transposition politique du matérialisme9. » De plus, selon Mounier, le fascisme n’a pas remis en cause « foncièrement les assises mêmes du capitalisme : primauté du profit, fécondité de l’argent, puissance de l’oligarchie économique10. »
En plein essor des totalitarismes, s’impose au mouvement non conformiste une réflexion sur les causes d’un tel développement : loin d’opposer démocraties libérales et totalitarismes, ils y voient au contraire un point commun lié à la généalogie de l’État moderne. Ainsi Mounier, dans son Manifeste au service du personnalisme (1936), pouvait écrire :
Le cancer de l’État se forme au sein même de nos démocraties. Du jour où elles ont désarmé l’individu de tous ses enracinements vivants, de tous ses pouvoirs prochains, du jour où elles ont proclamé qu’entre « l’État et les individus il n’y a rien » (loi Le Chapelier), qu’on ne saurait laisser les individus s’associer selon « leurs prétendus intérêts communs » (ibid.), la voie est ouverte pour les États totalitaires modernes. La centralisation étend peu à peu son pouvoir, la rationalisation aidant, qui répugne à toute diversité vivante : l’étatisme « démocratique » glisse à l’État totalitaire comme le fleuve à la mer11.
Ici encore, nous retrouvons dans certains écrits des non-conformistes une critique radicale de l’illusion d’un hypothétique salut révolutionnaire grâce à l’État.
On imagine mal des hommes parvenus déjà loin dans les voies de la personnalité abandonner si facilement ce trésor à l’un quelconque d’entre eux qui représente l’État, c’est-à-dire beaucoup moins que l’homme. En fait ils étaient déjà dépossédés. Où naissent les fascismes ? Sur les démocraties épuisées, au moment où la dépersonnalisation et l’anarchie sont telles que chacun n’aspire qu’au Sauveur qui reprendra tous ces problèmes effarants, toute cette masse décomposée, et fera des miracles alors qu’il n’a même plus, lui, le courage de son œuvre quotidienne12.
Le danger du fascisme est ainsi de deux ordres : il propose des illusoires et de dangereuses solutions tout en prospérant sur le terreau d’une démocratie libérale qui est incapable de tenir ses promesses d’origine (analyses similaires à celles que feront après la seconde guerre mondiale Arendt ou Camus). Mounier écrit ainsi en 1933 dans son article « Des pseudo-valeurs spirituelles fascistes » :
Nous dénoncerons plus profondément le fascisme comme un type d’attitude humaine, et la plus dangereuse démission qui nous soit aujourd’hui proposée. Pseudo-humanisme, pseudo-spiritualisme qui courbe l’homme sous la tyrannie des "spiritualités" les plus lourdes et des "mystiques" les plus ambiguës : culte de la race, de la nation, de l’État, de la volonté de puissance, de la discipline anonyme, du chef, des réussites sportives et des conquêtes économiques.
Et d’ajouter en guise de mise en garde : « Il faudrait que nos optimistes libéraux se le tiennent une fois pour dit : on ne combat pas une mystique par une mystique de rang inférieur. On ne combat pas l’explosion fasciste avec de larmoyantes fidélités démocratiques, avec des élections qui n’ont même pas la force de déplacer une des Puissances réelles du régime, avec des indignations sédentaires. » En ce sens, il est nécessaire de dépasser un antifascisme de façade, qui n’intégrant pas les causes du mal et ne proposant rien, devient l’auxiliaire policier d’un ordre qui meurt : « L’antifascisme est aujourd’hui la sentinelle ou – si l’on préfère une image civile – le concierge de la cité libre. On ne fait pas une cité heureuse avec le pouvoir des concierges. »
Dans cette perspective, la critique du totalitarisme par les non conformistes des années trente se veut large : il s’agit de ne pas établir une coupure nette entre les régimes soviétiques ou fascistes et la démocratie libérale dans la mesure où ils s’inscrivent tous dans une modernité dévoyée qui repose à la fois sur une masse d’individus indifférenciés et une oligarchie qui la plie à sa volonté :
Appelons régime totalitaire tout régime dans lequel une aristocratie (minoritaire ou majoritaire) d’argent, de classe ou de parti assume, en lui imposant ses volontés, les destins d’une masse amorphe, fût-elle consentante et enthousiaste, et eût-elle par là-même l’illusion d’être réfléchie. Exemples à des degrés divers : les "démocraties" capitalistes et étatistes, les fascismes, le communisme stalinien. Appelons démocratie, avec tous les qualificatifs et superlatifs qu’il faudra pour ne pas le confondre avec ses minuscules contrefaçons, le régime qui repose sur la responsabilité et l’organisation fonctionnelle de toutes les personnes constituant la communauté sociale. Alors, oui, sans ambages, nous sommes du côté de la démocratie. Ajoutons que, déviée dès ses origines par ses premiers idéologues, puis étranglée au berceau par le monde de l’argent, cette démocratie-là n’a jamais été réalisée dans les faits, qu’elle l’est à peine dans les esprits13.
Emmanuel Mounier entend ici reconsidérer la notion de démocratie dans sa dimension anarchisante dont il espère qu’elle adviendra mais pas à n’importe quel prix : comme il l’affirme explicitement, les anarchistes « nous préviennent encore contre une dernière tentation à éviter : celle de croire au mal nécessaire de l’État, cette sorte de timidité historique qui a amené toutes les révolutions à reconstituer les tyrannies14. » Contre cette timidité des tièdes consistant à vouloir concilier l’inconciliable, une certaine radicalité est revendiquée par-delà le clivage gauche-droite en cherchant un équilibre qui le transcende : « La droite lutte contre la mort, au risque d’arrêter la vie, la gauche lutte pour la vie, jusqu’à l’exposer à des expériences mortelles. »
Critique du capitalisme et du communisme
D’autre part, nous retrouvons dans le mouvement non-conformiste des années trente une critique conjointe du capitalisme et du communisme rejoignant en de nombreux points celle des anarchistes. Capitalisme tout d’abord : aussi bien Esprit qu’Ordre Nouveau considèrent que le capitalisme, légitimé par l’idéologie libérale, a consacré avec la propriété privée des moyens de production et le salariat un système d’iniquités dont ont fait les frais non seulement la classe ouvrière mais la société dans son ensemble. « Quand l’individualisme et le capitalisme s’affirment en défenseurs de la personne, et de l’initiative, et de la liberté, ils commettent le même mensonge que quand ils s’affirment en défenseurs de la propriété. Ils défendent le mot, pour mieux exproprier la chose15. » Il s’agit donc de reconsidérer les notions de propriété et de personne de manière à les inscrire dans des rapports égalitaires où chacun est associé à tous sans préjudice. En cela, notamment par le partage des charges et des biens la propriété peut devenir un facteur d’émancipation, conformément à la ligne de Proudhon qui parle de passer à la propriété comme vol (capitaliste) à la propriété comme liberté (autogestion). Pour autant, et c’est là une position similaire à celle de beaucoup d’anarchistes, on ne doit pas jeter le bébé (libéralisme) avec l’eau du bain (modernité) : il est acquis qu’il a permis aussi un développement des droits et des séparations des pouvoirs contre l’arbitraire de l’État et des communautés traditionnelles.
Il ne faut pas méconnaître que le libéralisme a dressé de justes revendications contre tous les dogmatismes collectifs, et par là rendu un implicite hommage à la vérité, qui transcende les sociétés comme les individus. Mais on ne libère pas les hommes en les détachant des liens qui les paralysent, on les libère en les rattachant à leur destinée. On les libère en les engageant là où, avec un peu d’effort, ils arriveront à reconnaître leur plus profonde autonomie. Le libéralisme pouvait prétendre à une mission négative, bien que déjà il la faussât par ses limitations mêmes. Du jour où il prétendit se suffire, il nous inventa ces "esprits" désincarnés, ces intelligences sans caractère, capables de comprendre toutes choses et tout être sans jamais se donner à chacun : le plus fin produit de la culture bourgeoise.
Communisme ensuite : Daniel-Rops, dans Éléments de notre destin, affirme que « La condition prolétarienne est à notre civilisation ce que l’esclavage fut au monde antique : chacun de nous en porte une part de déshonneur16. » Il ne faut cependant pas se méprendre sur l’illusion du marxisme qui prétend émanciper le prolétariat : capitalisme et communisme sont les frères jumeaux d’une idéologie matérialiste, sans morale, fondée sur l’intérêt. Robert Aron, dans la revue Ordre Nouveau, soutient ainsi que « La révolte marxiste, qui se voudrait audacieuse et novatrice, apparaît comme une reprise plus conséquente des thèmes fondamentaux de la société actuelle, comme un rigoureux achèvement réformiste des erreurs les plus monstrueuses du capitalisme17. » D’autre part, le marxisme, en prônant la dictature du prolétariat, retombe dans le même piège que toutes les idéologies fondées sur l’État comme moyen d’oppression légitime : Robert Aron et Arnaud Dandieu écrivent dans La Révolution nécessaire que « si le prolétariat au pouvoir constitue un État, aussi centralisé, aussi rigide, que les autres États, monarchiste, fasciste ou bourgeois, son vice profond sera le même et il aboutira fatalement aux mêmes abus ; ceux-ci ne sont pas le fait de telle ou telle classe, mais résultent d’une erreur spirituelle commune à toutes les classes, qui consiste à brimer l’individu au nom de cadres abstraits18. » Aron et Dandieu reprennent d’ailleurs dans cet ouvrage le texte prophétique de Bakounine sur l’hypothétique réalisation d’une dictature du prolétariat : « À l’intérieur, ce sera l’esclavage ; à l’extérieur la guerre sans trêve à moins que tous les peuples ne se résignent à subir le joug d’une nation essentiellement bourgeoise et d’un État d’autant plus despotique qu’il s’appellera l’État populaire. »
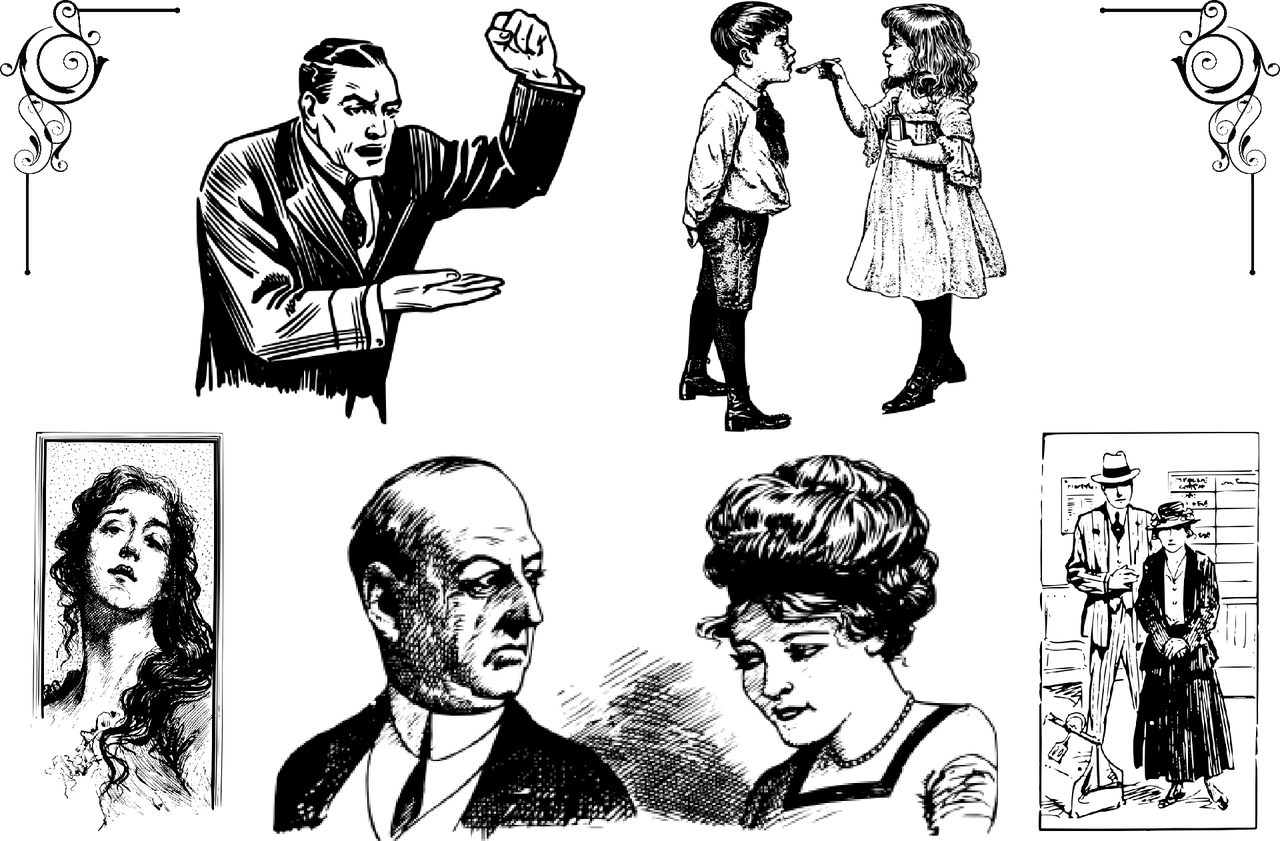
Perspectives fédéralistes
Cet ensemble de critiques s’accompagne de propositions politiques aux accents fortement libertaires, avec un focus particulier sur un fédéralisme à l’inspiration toute proudhonienne. Dans la plupart des écrits des non conformistes, la société est un fait qui n’existe cependant pas pour soi mais pour l’homme. Reprenant la terminologie proudhonienne, Robert Aron et Arnaud Dandieu affirment ainsi : « En opposition à ces sociétés animales purement grégaires, où l’individu ne vaut que par rapport à l’ensemble, la société humaine offre ce paradoxe qu’elle est avant tout an-archiste. An-archie n’est pas nihilisme selon une confusion grossière et trop fréquente : la société humaine ne tend pas à se détruire, mais bien à se subordonner aux intérêts spirituels de ceux qui la composent. » Dès lors, il convient de provoquer cette tendance et de la pousser jusqu’au bout, déviée jusque-là par des aristocrates qui l’ont subordonnée à leurs intérêts. Pour cela, il est nécessaire de concevoir une rupture révolutionnaire : « Un changement radical s’est toujours appelé une révolution. Si l’on a peur du mot, je crains bien que l’on n’ait peur de la chose. (…) le problème n’est plus de choisir entre la révolution et les demi-mesures, mais entre la révolution qui sauvera les valeurs humaines et celles qui les étrangleront19. » Cette révolution a un nom : le fédéralisme. « La révolution libère la nation en faisant éclater l’État et en dispersant les organes nécessaires de celui-ci dans deux directions : celle de la patrie locale d’une part, celle de la fédération révolutionnaire de l’autre, issue de l’élan des personnes considérées comme supérieures à tout20. » Ordre Nouveau proposait par exemple d’instituer entre les peuples européens des organismes supranationaux pour coordonner une planification du bas vers le haut de la production et de la consommation. D’autre part, l’État est dé-théologisé au point qu’il est écrit avec une minuscule dans les colonnes d’Ordre Nouveau :
L’état n’est ni au-dessus des patries, ni des nations : il est à leur service. Exécuteur des basses œuvres, il a sous sa compétence des fonctions de statistique, de sécurité, de classification, d’arbitrage administratif et économique. Ses initiatives sont rigoureusement limitées. L’initiative appartient en effet aux groupements locaux (communes et corporations) et aux divers organismes qui représentent les gouvernements locaux et les individus (cellules O. N, Syndicats, Groupements corporatifs)21…
Cet idéal libertaire de l’abolition de l’État et des classes sociales figure dans les derniers points du programme d’Ordre nouveau dans son Manifeste (1933)22 :
Ce régime doit entraîner par son jeu normal la disparition des cadres de l’État et du statut des classes, c’est-à-dire : l’élimination des facteurs décisifs de l’inflation, du chômage et de la guerre moderne économique et militaire.
C’est au nom d’antagonismes naturels féconds et créateurs que nous voulons éliminer les antagonismes artificiels et destructeurs que fait naître le capitalisme matérialiste.
Nous sommes avec le prolétariat, par-dessus la tête de ses meneurs, contre la condition prolétarienne.
Pour Alexandre Marc, la propriété doit être socialisée et non privatisée ou étatisée, ce afin de dépasser la fausse alternative du capitalisme et de communisme ou socialisme d’État. Il s’agira alors de concevoir une économie fédérale, démocratique et planifiée sans pour autant que le marché disparaisse. En effet, comme le souligne Alexandre Marc, « il ne saurait y avoir de marché libre sans plan, ni de planification sans économie de marché23. » Il s’agit de penser de manière polarisée l’économie planifiée et l’économie de marché. En cela, la dialectique dont résulte l’économie fédéraliste suppose la prise en compte de l’hétérogénéité de l’espace économique, contre les conceptions homogènes de cet espace, issues à la fois des idéologies libérales et marxistes. Alexandre Marc imagine alors la polarisation de l’économie réelle par sa distinction en deux zones : une zone A, soumise à une planification impérative, dédiée à la satisfaction des besoins, et une zone B, soumise à une planification indicative, dédiée à la satisfaction des désirs. Nous retrouvons particulièrement développée dans Ordre Nouveau l’idée de Minimum Social Garanti (MSG) qui anticipe les débats actuels sur le revenu universel inconditionnel :
Depuis le tout début des années trente, nous avons proposé que tous les citoyens de la future génération européenne soient assurés, dès leur naissance et jusqu’à leur mort – et ce, indépendamment du travail qu’ils accomplissent –, de pouvoir satisfaire – dans les cinq secteurs suivants : alimentation, habillement, logement, santé, culture – leurs besoins fondamentaux, à un niveau modeste, à la fois qualitativement et quantitativement moyen.
Comme chez Proudhon est alors développée l’idée de coordonner l’organisation autogérée des producteurs et des consommateurs, notamment en assurant la satisfaction des besoins fondamentaux. « Ce socialisme est qualifié de libertaire parce qu’il tend à réaliser ainsi un optimum de liberté sociale, en brisant les enchaînements du processus générateur de l’aliénation généralisée, par l’abolition de la condition prolétarienne dont le salariat n’est que l’un des composants. » Dans cette perspective fédéraliste, le droit n’est plus au service de l’État et de la propriété mais de la personne qui en est le sujet principal24 :
Une conséquence politique du personnalisme, qui marque bien l’opposition de ce système à ceux qu’on a fondés sur l’individualisme libéral, c’est le fédéralisme. L’individu étant conçu par les juristes à partir de l’ensemble, ses droits dépendent, en pratique, du bon plaisir de l’État. Tout au contraire des lois fondées sur la personne sont obligées de tenir compte en premier lieu des diversités personnelles, puis locales, puis régionales… On pourrait dire d’une manière un peu paradoxale, que ces lois perdent en puissance à mesure qu’elles gagnent en généralité. À mesure qu’elles s’éloignent du foyer vivant. Mais, de la sorte, le centre de l’autorité n’est pas dans l’État, il reste dans l’activité réelle de chaque personne, au sein de groupes d’autant plus forts qu’ils sont moins étendus.
En d’autres termes, comme l’affirme Mounier25, il n’existe pas de différence fondamentale entre le fédéralisme libertaire inspiré par Proudhon et les programmes d’Ordre nouveau ou Esprit dès lors que l’État n’est plus conçu comme organe coercitif :
Je ne vois plus guère de différence pratique entre les formules du Principe fédératif et celles de l’État d’inspiration pluraliste dont le personnalisme a plus d’une fois esquissé l’inspiration. (…) Que sera la forme nouvelle de cet État au service de la personne ? Ce que nous savons bien, avec les anarchistes, c’est qu’il n’a jamais été encore réalisé, nous ajouterions qu’il ne le sera jamais, sous un mode utopique, et qu’il devra être constamment reconquis, même sur de plus souples approximations, à la pente fatale des pouvoirs.
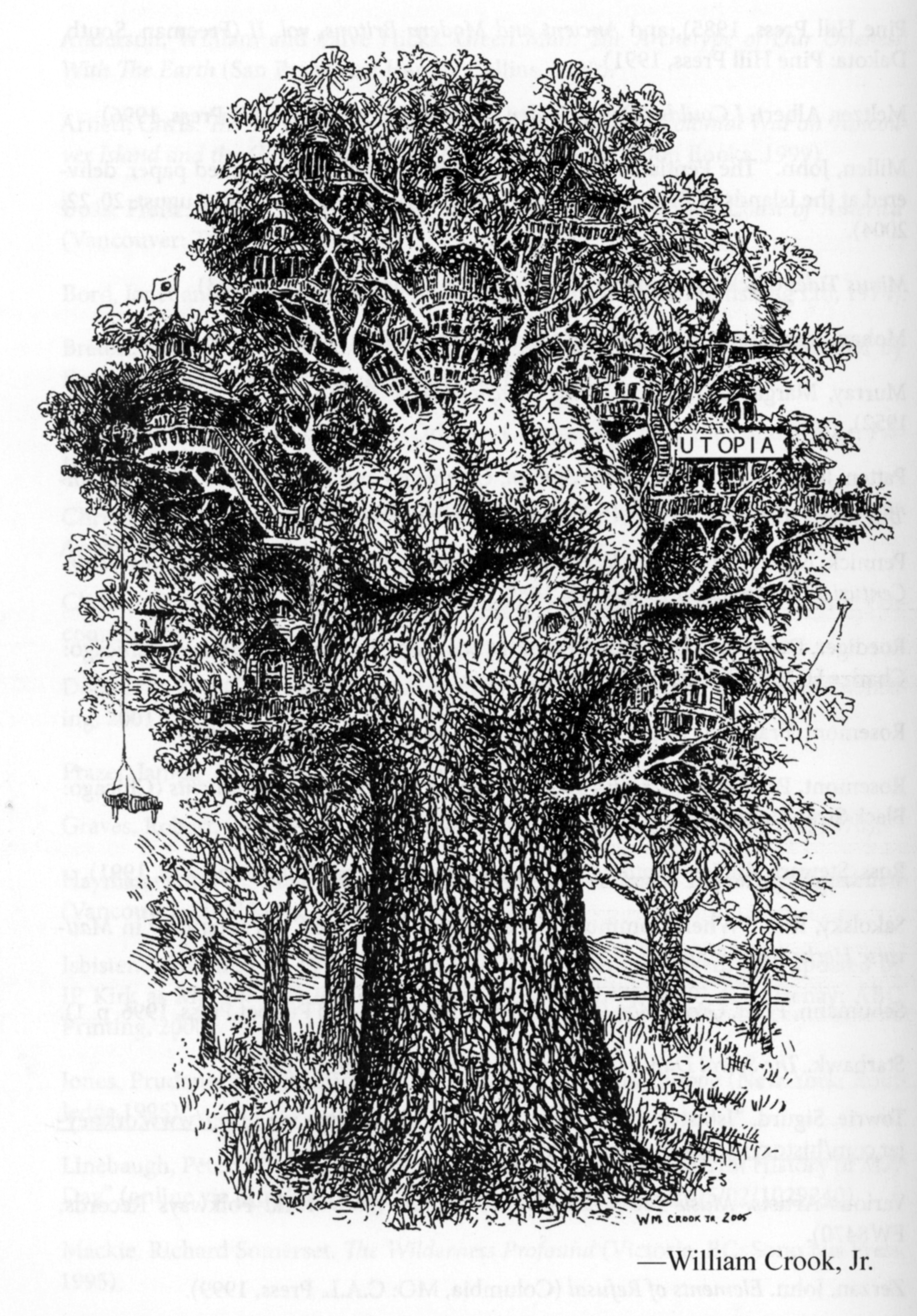
Les affinités sont multiples entre les idées du mouvement des non conformistes des années trente et le mouvement anarchiste, au point qu’il importe sans doute de pointer quelques différences qui relèvent parfois de malentendus ou d’imprécisions. Emmanuel Mounier, dans son essai sur « Anarchie et personnalisme », reproche notamment aux anarchistes de ne pas voir que l’autoritarisme peut aussi venir de la base (il évoque notamment les prophètes plébiscités par les peuples) et qu’il ne suffit pas de se dresser contre l’État pour se soustraire à la domination. Il critique aussi parfois un rapport manichéen aux religions et plus particulièrement au christianisme dont il affirme que bien compris il est tout à fait compatible avec une politique anarchiste (il rejoint ici les futurs développements de Jacques Ellul). Enfin, il se montre méfiant vis-à-vis d’un certain économicisme que l’on trouve dans le communisme libertaire de Kropotkine affirmant la possibilité de l’abondance : pour Mounier l’abondance est un mythe moteur du capitalisme lié à l’idéal d’une production et d’une consommation sans limite. Il importe davantage de concevoir une certaine frugalité compensée par le potentiel infini des capacités créatives de la personne (anticipant en cela les débats actuels sur la question des limites de la croissance). Autant de critiques qui, on le voit, sont loin d’être des objections de fond tant ces questions font toujours aujourd’hui l’objet de débats contemporains dans le mouvement anarchiste.
Laissons pour terminer le mot de la fin au fondateur d'Esprit26 :
Il n'est de liberté que sur un ordre de choses, et parmi des hommes. Mais si rigoureux soit l'itinéraire qui nous est fixé en certaines époques de crise, si étroite l'initiative que nous permet le coude à coude du salut public, cette dure guerre ne reste une guerre d'homme que si la liberté guide nos pas. Tel est le message profond de la pensée anarchiste sans ses enfantillages et sans ses utopies. Résumons-le, pour finir, par un de ses textes les plus incisifs.
« La véritable outrecuidance consiste à accorder à certains individus la perfection de l'espèce… Vous croyez que vos institutions d'État sont assez puissantes pour changer un faible mortel, un fonctionnaire, en saint, et lui rendre possible l'impossible. Mais vous avez tellement peu confiance en votre organisme d'État que vous craignez l'opinion isolée d'un particulier… L'instruction [sur la censure] demande que l'on témoigne une confiance illimitée à la classe des fonctionnaires, mais elle part d'une défiance illimitée envers la classe des non-fonctionnaires. Pourquoi ne pratiquerions-nous pas la loi du talion ? Pourquoi la classe des fonctionnaires ne serait-elle pas précisément suspecte ? Même observation pour le caractère. Et de prime abord, l'homme impartial doit accorder plus d'estime au caractère du critique public qu'à celui du critique secret… C'est parce qu'il a une vague conscience de tout cela que l'État bureaucratique s'efforce de placer la sphère de l'anarchie assez haut pour qu'elle disparaisse aux regards ; il se figure alors qu'elle est évanouie. »
Ce texte, ne le cherchez ni chez Proudhon malgré l'attaque haletante et serrée de la phrase, ni chez Bakounine ni dans Kropotkine, ni chez aucun de ceux que nous avons cités. Il est de Marx, parlant de la censure allemande. C'est une preuve que la vérité implicite de l'anarchisme, comme écrivait Proudhon par gentillesse, n'appartient à personne, et que chacun peut en faire profit.
Comment j’ai failli devenir anarchiste Le Grand Refus poétique
