Anarchismes, Ultra-gauche et Conseillisme au tournant des années 1970
Anarchismes, Ultra-gauche et Conseillisme au tournant des années 1970
Entretien avec Jean-Pierre Duteuil
Jean-Pierre Duteuil, militant anarchiste, a participé à Noir et Rouge, au 22 mars, à ICO, et à la Lanterne noire ; membre de l’OCL et rédacteur du mensuel Courant alternatif. Il a fondé les éditions Acratie dont il s’occupe toujours.
En 1954 une scission se produit à la FCL (Fédération communiste libertaire, ancêtre de l’actuelle UCL) qui a fait le choix de se présenter aux élections et qui adopte des positions de plus en plus partidaires et avant-gardistes. Les dissidents se regroupent dans les GAAR (Groupes anarchistes d’action révolutionnaire) et publient en 1956 le premier numéro de la revue Noir et Rouge. En 1961 une partie des GAAR rentre à la FA (Fédération anarchiste) comme tendance (UGAC, Union des groupes anarchistes communistes). La revue poursuit son chemin, animée par un groupe éponyme d’une vingtaine de militants, jusqu’en 1970. 46 numéros d’un parcours politique qui se fonde sur la reconnaissance de la lutte des classes (d’où l’accusation de « marxisme » de la part des anarchistes qui ne la reconnaissent pas), d’un soutien critique aux luttes de libération nationales, d’une critique du syndicalisme et du réformisme autogestionnaire, et d’un refus de tout avant-gardisme (ce qui les rapproche des conseillistes).
Au milieu des années soixante, il y a eu des relations entre Noir et Rouge et certains groupes d’ultra-gauche ou dissidents du trotskisme, comme Socialisme ou Barbarie1. Comment cela s’est-il mis en place ? De quelle nature était ce rapprochement ? Politique ou plutôt amical ? Quelle était la part de la situation politique de ces années-là ? S’agissait-il de « dépasser le marxisme et l’anarchisme » et d’établir des passerelles ? S’agissait-il de la participation à des actions communes ou plutôt d’une recherche d’analyses communes, sans pour autant agir ensemble ?
Certes, il était parfois question de dépassement du marxisme et de l’anarchisme (et même de marxisme libertaire, théorisé par Daniel Guérin) mais je ne pense pas que ça soit là l’essentiel du fond commun à la mouvance dont nous parlons ici. Tout au plus une tentative de théoriser quelque chose de plus essentiel, qui est tout ce qui tourne autour du concept d’autonomie, du refus d’un parti d’avant-garde pour conduire un processus révolutionnaire qui ne peut être que global… et c’est une longue histoire.

En 1906, la CGT se dote d’une Charte dite d’Amiens qui considère que les exploités doivent gérer eux-mêmes2 la lutte révolutionnaire menant vers une société sans classe et qu’il n’est nul besoin de parti ni de parlement pour la guider ou la représenter.
Il s’agissait là de la réaffirmation d’un cheminement qui avait débuté dans la Première Internationale, pour qui « l’émancipation des travailleurs doit être l’œuvre des travailleurs eux-mêmes ». Autrement dit c’est le principe d’autonomie qui est seul susceptible de mener au renversement de la société capitaliste.
L’année précédente, la création de la SFIO (Section française de l'Internationale ouvrière) – sur la base d’une réunification de plusieurs partis socialistes – ouvrait une ère de rupture avec ce principe, estimant de fait qu’il était nécessaire de construire un parti d’avant-garde et de jouer le jeu du parlementarisme. C’est à partir de ces affirmations en opposition avec les origines de l’Internationale et du syndicalisme révolutionnaire que se développèrent ensuite les deux frères ennemis que furent la social-démocratie et le marxisme-léninisme.
Dire que cette rupture n’est que l’illustration d’une division structurelle entre anarchistes et marxistes serait une erreur. D’une part il ne faut pas oublier que certaines tendances anarchistes penchaient vers la formation d’un parti d’avant-garde et que les exemples de participation à des élections et à une gestion gouvernementale sont connus. D’autre part, à partir de la Révolution russe, différents courants marxistes n’acceptèrent pas la vulgate léniniste et évidemment encore moins stalinienne : sur le plan théorique et organisationnel, citons les gauches communistes allemandes et hollandaises avec Herman Gorter et Anton Pannekoek. Ces courants irriguèrent les révolutions de l’entre-deux-guerres : conseils ouvriers de Bavière (1918-19), de Turin (1919-20), de Barcelone 1936, etc. et se retrouvèrent alors souvent très proches de groupes anarchistes révolutionnaires dans ces mêmes luttes sociales et ces révolutions, en Bavière avec Erich Mühsam et Gustav Landauer, à Turin avec Maurizio Garino*, par exemple.
On notera qu’en France un éphémère parti communiste est créé en 1919 sous l’impulsion de Raymond Péricat3 qui regroupe des éléments se revendiquant à la fois de l’anarchisme et d’une gauche marxiste éloignée du léninisme.
C’est de ces expériences basées à la fois sur l’adhésion et l’enthousiasme pour les mouvements révolutionnaires de l’après première guerre mondiale, sur le refus de l’avant-gardisme et en faveur de l’autonomie des exploités, que se sont construites par la suite des mouvances activistes aussi bien que théoriques, souvent en conflit entre elles bien sûr, qui parsèment l’histoire sociale ouest-européenne depuis l’entre-deux-guerres. Mouvances qui, de scissions en recompositions, ont surfé sur les luttes sociales, les guerres et les révolutions, en tentant d’y intervenir et de les interpréter.
ICO (Informations et correspondances ouvrières) fut un de ces multiples lieux. Concrètement c’est dans ILO (Information et liaisons ouvrières) et surtout dans ICO que le rapprochement s’est matérialisé. ILO est issu d’une scission de S ou B (Socialisme ou Barbarie), créé par Henri Simon et Claude Lefort en 1958, qui deviendra ICO en 1962 (puis Échanges et Mouvement). S ou B se dissout en 1967, après avoir théorisé qu’il ne pouvait plus rien se passer dans la société française ! Ce qui restait de S ou B n’y voyait aucun signe d’une possible rupture avec le capitalisme, considérant que la classe ouvrière s’intégrait de plus en plus.
Participèrent à ICO des anarchistes déclarés comme Christian Lagant du groupe Noir et rouge et Pierre Blachier de la FA (Fédération anarchiste) et surtout du comité de lutte Renault (citons aussi Marcel Kouroriez, ouvrier au Monde). Ensuite, un ou deux ans avant Mai 68, quelques anars de la Liaison des étudiants anarchistes (LEA), suivirent d’assez près ce qui se faisait et se disait à ICO, beaucoup plus par ce qu’en rapportait Lagant que par une participation réelle et suivie. À noter que des deux côtés la méfiance vis-à-vis de S ou B était de mise. Côté ICO évidemment, puisque c’en était une scission d’orientation plutôt conseilliste. Côté Noir et rouge, parce que S ou B considérait un peu de haut les anars considérés comme faibles en économie4.
Et puis il y avait la personnalité émergente de S ou B, Cornelius Castoriadis, qui représentait la figure même de l’intellectuel, alors qu’à l’époque la critique de la division entre manuels et intellectuels constituait un des axes récurrents de la mouvance dont nous parlons. Signalons, en outre, que Castoriadis considérait le capitalisme bureaucratique d’État en URSS comme le stade le plus achevé du capitalisme, si bien qu’il avait tendance parfois à en faire l’ennemi principal, au détriment du classique « ni-ni » prôné par la tradition internationaliste.
Le rapprochement entre ICO et Noir et Rouge n’a pas été le fruit d’une décision de groupes, mais de deux conceptions communes contre l’avant-gardisme (positions que l’on peut rapprocher du conseillisme). Et donc dans la filiation commune de l’autonomie. A. Pannekoek était une figure respectée des deux côtés, comme H. Gorter de la gauche communiste, une figure lui aussi du conseillisme, dont la Réponse à Lénine était plus notre livre de chevet que Marcuse ou Lacan. En fait le ciment était l’anti-léninisme qui était aussi partagé par d’anciens trotskistes ou proches, comme ceux qui travaillaient chez Hispano-Suiza ou Simca près de Nanterre (Ngo Van, et Paco [Gomez] et Agustin issus du POUM).
« Anti-léniniste » était un terme qui était beaucoup plus utilisé que « libertaire » à l’époque pour désigner un élargissement possible, des rapprochements, une aire commune avec certains marxistes.
Il s’agissait donc des deux côtés de gens dissidents des orthodoxies, cherchant à se rapprocher des origines du mouvement ouvrier de la Première Internationale : « l’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes ». Côté anarchiste, le projet était de remettre la lutte des classes au premier plan, question sérieusement abandonnée par la Fédération anarchiste, mais présente chez les marxistes. Côté « marxiste », il s’agissait de réaffirmer l’autonomie ouvrière, sérieusement écornée par le stalinisme et le léninisme, mais présente et soutenue par les anarchistes.
Mais plus que d’accords théoriques sur le papier, en congrès ou en réunions, c’était une rencontre sur le terrain pratique, je dirais même activiste pour nous, dont il s’agissait. Les échanges se faisaient le plus souvent à propos de luttes concrètes dans lesquelles nous étions présents et dans lesquelles il s’agissait de trouver une manière d’agir en dehors de la construction du parti ou de la vulgate syndicale.
N’oublions pas qu’ICO était essentiellement constitué de récits de camarades sur ce qui se passait sur leur lieu de travail et sur les conflits, importants ou non, qui s’y déroulaient ; ce qui, évidemment suscitait des commentaires et des discussions. Il y avait aussi le soutien aux camarades espagnols, souvent emprisonnés.
Nous étions loin de débats plus ou moins académiques, il s’agissait d’échanges sur nos vécus militants dans les milieux (de vie ou de travail) où nous nous trouvions.
Le rôle de 68, avec le bouillonnement de l’action et des débats, et un certain éclatement des groupes traditionnels, paraît important. Qu’est-ce qui a bougé dans les relations entre ces groupes anars, et ultra-gauche ?

La rencontre de ces deux mouvances s’incarna pendant les événements de mai dans la publication de deux brochures, La grève généralisée en France et L'autogestion l'État et la Révolution (parues en juillet 1968 comme supplément commun à Noir et rouge et à ICO). Ensuite ICO devint le lieu de rencontre, sur le plan parisien, national et même international, de cette mouvance « anarcho-conseilliste-ultragauche », et des multiples groupes « radicaux » qui se constituèrent dans l’après-Mai. Certains groupes, comme Noir et Rouge, disparurent vers 1973.
Et ce qui a changé, c’est la multiplication de ces groupes « à la lisière », qui ont en partie imprégné le paysage politique d’extrême gauche (et que l’on retrouve un peu plus tard dans « l’autonomie parisienne »).
De nouveaux thèmes sont apparus dans ce début des années soixante-dix qui modifiaient les approches classiques, tout en gardant le cadre d’une analyse en termes de classes : par exemple, l’autonomie, l’autogestion, la lutte contre l’aliénation, etc. Était-ce des idées partagées par ces groupes ? Ces nouvelles approches (entre autres la prise en compte de la vie quotidienne, au-delà de la simple exploitation) et nouvelles luttes (FHAR, féminisme, front de la jeunesse, lutte des lycéens etc.) ont-elles joué comme ciment ou ont-elles imposé des limites au rapprochement entamé ?
Ces mots ont eu une histoire et ont été approchés de manière différente. Autonomie (ouvrière) était un vieux concept dans le mouvement ouvrier (voir la CGT d’avant 1914) qui résonnait positivement pour des anarchistes. Il en était de toute autre manière pour autogestion qui était un concept relativement récent, amené par la nouvelle gauche (Serge Mallet, la CFDT, etc.) que n’appréciait guère le courant « anarcho-conseilliste » (dont nous parlons un peu ici, sans que la définition soit satisfaisante) en ce qu’il signifiait plus ou moins « gérer la société telle qu’elle est », « autogérer la misère », « s’auto-exploiter ». Bref, se faire avoir ou avoir les autres.
Le mot autogestion (comme « libertaire » d’ailleurs), servait à rendre présentable et à adoucir le vieux mot de révolution qui était jugé susceptible de faire peur aux « masses ». Il convenait donc mieux à cette nouvelle gauche qui entendait à terme devenir un parti de gouvernement et ne pas se limiter à une contestation de rue ou d’entreprise. Certains anarchistes aussi qui, sans projeter un avenir gouvernemental, voulaient rendre l’anarchisme plus présentable. Ce qui n’était évidemment pas le cas de l’ère politique dont nous parlons.
La lutte contre l’aliénation, oui sans doute, c’était un bagage commun. Encore faudrait-il préciser davantage. Mais remarquons sur ce terrain que le Lukács d’Histoire et conscience de classe était lu. Que les textes de Wilhelm Reich étaient à l’ordre du jour (et leur mise en pratique) aussi bien par les anars du CLJA (Comité de liaison des jeunes anarchistes) / LEA que par les Anglais de Solidarity proches d’ICO.
Notons que des deux côtés la critique de l’autogestion était présente (par exemple critique de l’autogestion en Yougoslavie dans Noir et Rouge vers 1964).
Ces nouvelles approches sont apparues dans un contexte de montée de la revendication sociale, si bien qu’elles ont été colorées par les affrontements de classes. La bourgeoisie reprenant petit à petit l’offensive et menant la lutte des classes en sa faveur, comme le disait le milliardaire américain Warren Buffet5, ces nouvelles approches, au lieu de continuer à enrichir le mouvement révolutionnaire d’aspects de l’oppression souvent ignorés ou mis de côté, se sont trouvées progressivement coupées de leurs racines, un peu hors sol et donc réduites à une dimension culturelle.
Les marxistes reprochent traditionnellement aux anarchistes l’absence de réflexion économique, et aussi l’absence de prise en compte du politique, les anarchistes identifiant le politique à l’État, et envisageant donc la suppression du premier avec le second. Est-ce que cette question traversait les débats à l’époque (années soixante/soixante-dix), et quelle évolution s’est produite dans ces groupes ?
Effectivement les anars qui se retrouvaient en partie dans le conseillisme étaient considérés comme « marxistes », donc pas de vrais anarchistes, par les orthodoxes de la Fédération anarchiste. Mais ils ne se retrouvaient pas non plus dans la tendance (considérée comme marxiste elle aussi par les orthodoxes) dite plateformiste (ancienne FCL, Fontenis, Tout le pouvoir aux travailleurs, Alternative libertaire, puis Union des communistes libertaires UCL), qui retenait du marxisme plus les options organisationnelles que la vision plus libertaire d’un marxisme développée par Maximilien Rubel.
N’oublions pas que jusque dans les années soixante-dix la FA ne reconnaissait pas la lutte des classes. Mai 68 l’a fait tardivement changer de position après que de nombreuses vagues de départs avaient eu lieu : en 1966, dix ou quinze groupes (dont celui de Nanterre) nommés « hydre de Lerne » par Maurice Joyeux (le militant emblématique de la FA), considérés par la majorité de la FA comme « marxistes » ; en 1968 c’est la tendance dite ORA (Organisation révolutionnaire anarchiste) qui la quitte sur la base de la reconnaissance de la lutte des classes et fonde sa propre organisation qui deviendra l’OCL (Organisation communiste libertaire). Les uns comme les autres tisseront plus ou moins des liens de proximité avec les conseillistes « marxistes », et avec la galaxie de groupes qui se retrouvent à un moment ou à un autre proche ou dans ICO : Théorie communiste (devenus communisateurs), Archinoir, Jeune taupe (PIC), et de nombreux groupes locaux dans toute la France, etc. Tous produisent des textes/brochures/revues que l’on trouve à l’époque à la librairie Parallèle qui est dans les années soixante-dix le lieu de passage de cette mouvance, comme l’avait été dans l’avant 68 la librairie la Vieille Taupe, lieu de lecture ultra-gauche marxiste et conseilliste.
À la fin des années soixante-dix se dessine une nouvelle version de ces mouvances anarchoïdes, l’autonomie « parisienne ». On y retrouve une certaine filiation avec la période précédente, mais aussi l’influence de l’autonomie italienne. Cette dernière est très plurielle avec des influences anarchistes et d’autres tirant du côté d’un néo-léninisme allant jusqu’au maoïsme. En France c’est la première qui me semble dominante et qui débouchera plus tard d’un côté sur un renforcement des tendances anars « lutte des classes » et de l’autre sur l’insurrectionnalisme et l’appellisme.
Au même moment se produit la casse de la sidérurgie avec de véritables émeutes du côté de Longwy, de la Chiers, de la pointe de Givet, et même à Paris, lors de la grande manifestation nationale des sidérurgistes dans laquelle une liaison se produit dans la rue avec l’autonomie parisienne. C’est aussi l’époque de la grande grève des mineurs anglais. Évidemment on ne peut pas dire que sidérurgistes et mineurs sont devenus des autonomes ou des anarchistes mais, en délicatesse avec les directions syndicales, émergent des éléments qui se structurent à côté des centrales (voir Hagar Dunor, Longwy 82-88, autonomie ouvrière et syndicalisme, Acratie 1990, ainsi qu’Henri Simon, La grève des mineurs en Grande-Bretagne (1984-1985), Acratie, 1987).
Si on suit le fil conducteur de l’autonomie (pour, par et dans la révolution), on retrouve aussi ces points communs dans cette sphère politique :
– L’URSS est un capitalisme d’État et non un État ouvrier dégénéré.
– L’antifascisme comme ligne politique structurante ne saurait être efficace contre le fascisme dans la mesure où il prône et implique une alliance de classe avec la bourgeoisie libérale qui est elle-même à l’origine du fascisme.
– La destruction de l’État, l’abolition du salariat et de la monnaie, la disparition des classes sociales sont au cœur même du projet et de la pratique révolutionnaires.
– « De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. »
Que peut-on tirer aujourd’hui de cette histoire politique ? Les débats actuels structurés par les conflits modernes/postmodernes, identitaires/luttes sociales, etc., paraissent très éloignés tant des termes du débat que des enjeux de l’époque. Quelle trace a laissé cette période ?
Les post… ou disons les intersectionnels, n’ont pas inventé grand-chose. Ce qu’ils mettent en avant, les oppressions spécifiques, étaient déjà évoquées dans le mouvement ouvrier traditionnel, mais bien sûr pas suffisamment, et trop souvent comme des questions secondaires qui seraient résolues après le Grand Soir. Or, ce ne sont pas les analyses postmodernes qui ont replacé ces questions au grand jour mais bien l’intensité du mouvement social, en particulier la grève générale de 1968, qui a ouvert les vannes permettant que ces mouvements s’expriment par eux-mêmes et non par la grâce d’une avant-garde éclairée, d’une petite bourgeoisie intellectuelle, parlant au nom de tous et toutes. Dans les années soixante-soixante-dix le fonds de conflictualité sociale au niveau mondial fut un terrain favorable pour que les oppressions spécifiques puissent s’exprimer d’emblée sur un terrain de lutte globale.
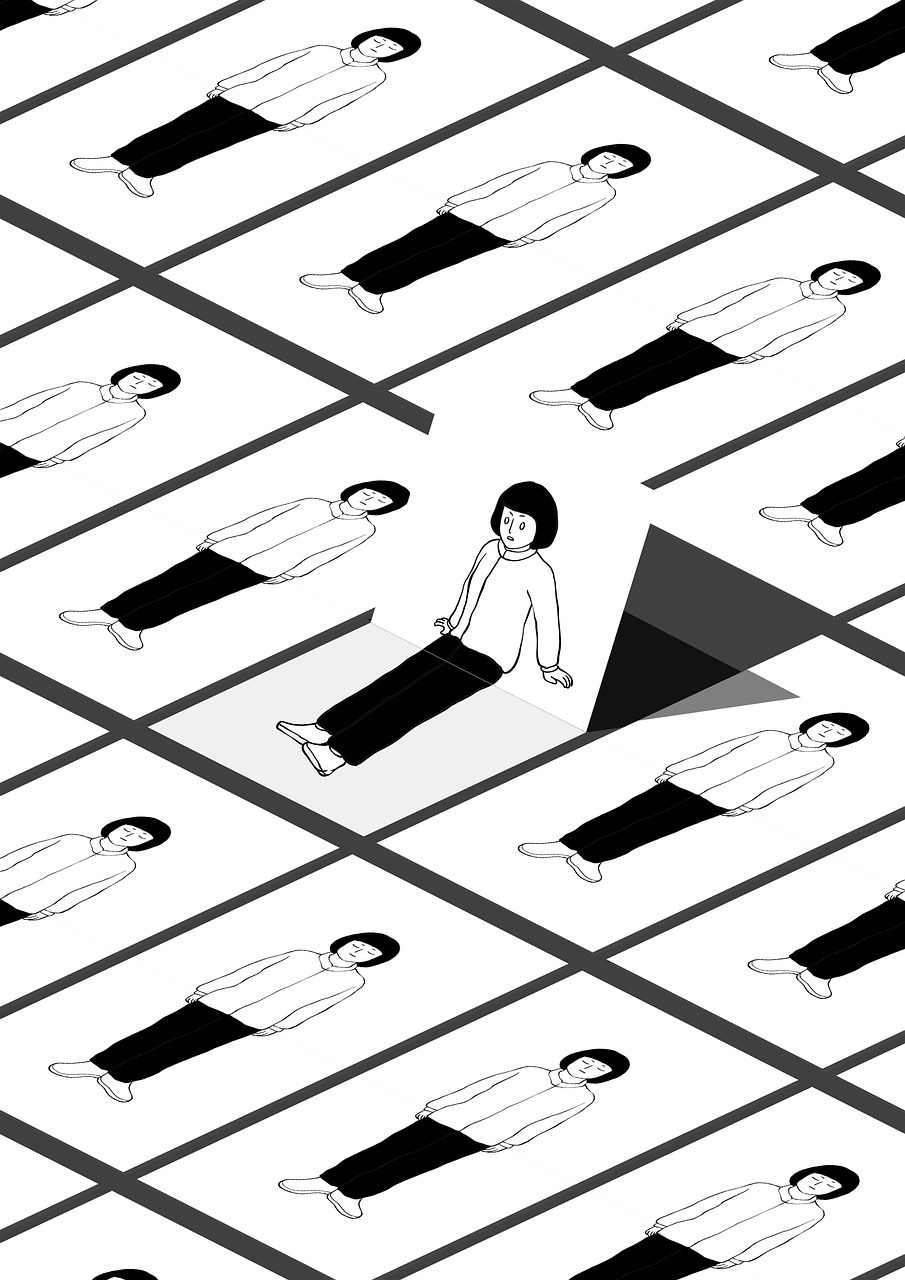
Une vague sociale avait déferlé, ramenant à la surface des questions jusque-là existantes mais peu visibles et peu prises en compte. La vague s’est progressivement retirée (provisoirement ?), les laissant sur le sable, très visibles mais inertes ; les mouvements sont devenus des chapelles, à l’image de ce qui s’est produit dans le mouvement ouvrier après les explosions révolutionnaires qui laissèrent sur le sable des petits cailloux groupusculaires, rappel fossilisé de la vague qui les avait portées, et tous candidats à mener le bon peuple vers l’émancipation.
Comme exemple des conséquences du reflux, citons l’évolution du mouvement homosexuel illustré par la différence criante entre le FHAR – front homosexuel d’action révolutionnaire – des années 1970 et la mouvance LGBTQI++ actuelle qui vise à être présente jusque dans allées du pouvoir après avoir réhabilité le mariage.
Le postmodernisme s’est construit sur l’oubli, voire le déni, de ce qui avait permis le passage de simples questions et « problèmes » formels en mouvement réel, et a eu comme effet souvent explicite de faire de l’exploitation sociale un simple élément de plus dans la longue liste des dominations en se plaçant en dehors des analyses de classe et de la recherche d’un rapport de force global. En fait les idéologies « post » sont des vaincues qui accompagnent les périodes de recul mais qui s’estompent dès que la conflictualité sociale remonte. Elles sont le fruit amer d’un rapport de forces favorable à la bourgeoisie dans cette lutte des classes qu’ils ne veulent pas considérer comme fondamentale, voire simplement existante.
Propos recueillis par Heloisa Castellanos et Monique Rouillé
À propos de René Lefeuvre et des éditions Spartacus Comment j’ai failli devenir anarchiste
