Commentaire autour de l’an-arkhè et de ses prolongements politiques
Commentaire autour de l’an-arkhè et de ses prolongements politiques
Monique Rouillé-Boireau
En cette fin d’hiver 2022 l’anarchisme semble revenir sur le devant de la scène éditoriale. Avec la publication des livres de Catherine Malabou, Au voleur, anarchisme et philosophie, et de Reiner Schürmann, Se constituer soi-même comme sujet anarchique1, on assiste à un renouveau des interrogations philosophiques autour de l’anarchisme. Et une idée « flotte » dans l’air du moment : les théories de la déconstruction2 seraient « la » philosophie de l’anarchisme, de par leur radicalité dans la critique de la domination, leur lucidité ; en effet, ces théories mettent l’accent sur la condition ontologique moderne de perte des fondements, de tout principe originaire, an-arkhè, puisque l’arkhè c’est le principe premier, le commencement engendrant un commandement. Il y aurait une convergence entre l’anarchie et la déconstruction, puisque l’anarchie renvoie à l’impossibilité de l’ordre politique à se fonder lui-même. L’évidence apparemment indiscutable de ces positions, leur séduction intellectuelle aujourd’hui, rejoignent l’attrait exercé par ces théories dans les milieux militants et libertaires tout particulièrement. La philosophie de la déconstruction jouirait d’une sorte de supériorité dans la radicalité critique qui l’autoriserait à avoir une évidente proximité avec l’anarchisme.
La question des rapports entre anarchisme et philosophie n’est pas nouvelle3 ; on trouve souvent cité Proudhon : « l’action, c’est l’idée », pour noter une sorte d’incompatibilité entre philosophie et anarchisme, tant idée et pratique y sont inséparables : « l’anarchisme est une nébuleuse d’idées liée au faire » 4 écrivait Vivien Garcia, la théorie y est tirée de la pratique. Certes, mais celle-ci doit néanmoins être dite, formulée ; comme il le précise, on ne peut figer un champ conceptuel anarchiste mais, néanmoins, l’anarchisme affirme une ontologie qui lui est propre et qui est l’absence de principe premier, de fondement sur quoi asseoir un commandement. Et cette ontologie ne cesse d’interroger, car les questions sont bien celles de « l’agir » politique, du faire, et des façons dont on peut l’envisager (on ne peut dire le « fonder » puisque le problème réside là précisément), celles aussi de la liberté, de l’autonomie dans un monde sans référent.
Pour dire les choses autrement, peut-on passer de l’an-archie à l’anarchisme politique ?
Ce pas semble infranchissable pour les auteurs étudiés par C. Malabou, qui rejoint là le constat fait il y a quelques années par M. Cervera-Marzal5. Ce dernier avait formulé en 2015 une question proche de celle reprise récemment par C. Malabou : et si certains philosophes n’étaient que des anarchistes qui s’ignorent ? Et quel est alors le pourquoi de ces dénégations ? Il avait étudié cette question à travers un corpus d’auteurs différents, Miguel Abensour, Cornélius Castoriadis, Claude Lefort et Jacques Rancière – philosophes politiques français qui ne bénéficient pas de l’aura médiatique des auteurs « french theory » ou post-heideggériens étudiés récemment (Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Reiner Schürmann, Michel Foucault entre autres) –, et il avait posé ce paradoxe de philosophes opérant une critique radicale de l’arkhè, montrant leur attachement au principe d’an-archie et refusant de se dire anarchistes.
Chez les auteurs étudiés tant par C. Malabou que par M. Cervera-Marzal, on trouve à première vue la même critique an-archique à l’encontre de l’anarchisme, qui fait que pour être fidèle à son principe « d’absence radicale de fondement », l’anarchisme politique, par sa simple existence, ne pourrait que se nier d’une certaine façon. Chez ces auteurs, l’anarchisme est rejeté ou critiqué au nom de l’anarchie. Paradoxe.
Ce « refoulement » d’un héritage anarchiste se traduit pour C. Malabou par le fait que ces philosophes n’arriveraient pas à envisager le « non-gouvernable », tandis que les auteurs étudiés par M. Cervera-Marzal, s’ils reprochent aux anarchistes de manquer la dimension du politique comme tel (en raison du rejet de l’État), reconnaissent une sorte de légitimité politique au mouvement anarchiste.
Ces réponses posent évidemment un problème : de quel anarchisme politique nous parlent ces auteurs ? On rejoint là le constat fait par V. Garcia à propos des post-anarchistes6 : leur vision de l’anarchisme dit « traditionnel » est souvent très éloignée des anarchismes politiques réels, ces auteurs se référant à un « bloc », alors que les anarchismes sont divers, et présupposant un attachement, qui serait dépassé, aux idées de raison et de nature. La philosophie de la déconstruction serait-elle alors comme une sorte de vérité révélée de l’anarchisme ?
Il va s’agir ici, moins d’interroger cette identification de l’anarchie à la philosophie de la déconstruction, que de voir si le post-heideggeérianisme est la seule philosophie apte à penser la condition politico-philosophique moderne, ou si d’autres philosophies (celle de C. Castoriadis en particulier) qui construisent leur pensée sur un même constat (incontournable puisque c’est la banalité de la condition moderne, nous campons en quelque sorte sur le vide, la fin de l’hétéronomie7 nous constitue) et abordent la question tout aussi radicalement mais avec d’autres prémisses, n’ouvrent pas des portes plus pertinentes pour penser « an-archiquement l’anarchisme » ; il s’agit donc d’analyser les prolongements politiques de ces options théoriques.
Sujet et politique
R. Schürmann est l’un des penseurs qui a orienté sa réflexion sur un devenir politique possible de l’an-archie ontologique, tout en se différenciant très clairement de l’anarchisme politique « classique ». Prolongeant la « déconstruction » de Heidegger dans une optique foucaldienne, il constate que la condition ontologique moderne de « perte des fondements » libère une origine rebelle au commandement et à la domination, l’origine se montre an-archique. Comment alors se constituer soi-même comme agent d’activités et de pratiques, puisqu’il devient impossible de dire « je suis anarchiste » sans annuler le sens même de l’an-arkhè ? L’anarchisme ne peut donc que se confondre avec la déssaisie, la délégitimation8, et l’anarchisme politique « classique » demeure à ses yeux « métaphysique »9, puisqu’au lieu d’être fidèle à son concept et d’accepter l’absence de fondement, il opérerait un déplacement du principe originaire, de l’autorité à la raison ; pour Schürmann, à l’âge moderne, le sujet réflexif jouerait, de manière erronée, le même rôle fondateur que Dieu ou la Nature auparavant. Donc si l’anarchiste était conséquent, il reconnaîtrait qu’il est pris dans une situation où toute tentative de maîtrise d’actions ayant une finalité se trouve piégée, car contredisant le principe d’an-archie. Il ne peut alors que demeurer dans les limites d’un ici et maintenant de l‘expérience sensible, dans l’optique de la finitude et de la déprise10 (pour résumer et simplifier) c’est-à-dire se constituer comme « sujet anarchique ».
Pour dire les choses autrement, la seule attitude politique que puisse prendre le sujet, c’est de rendre compte de la « clôture » dans laquelle il est placé, des « dispositifs »11 qui l’enserrent, et alors de « s’implanter dans le lieu étroit et variable laissé ouvert par les constellations discursives et les effets de pouvoir »12. Toute autre posture philosophique ne serait que recherche de réassurance, consolation, consolidation. Tout se passe comme si tout agir était, par définition, pris au piège d’un référent transcendant. Ainsi l’émancipation ne peut être conçue comme une valeur pour laquelle on lutterait en développant l’autonomie individuelle et collective, sans se voir taxée d‘être sous l’emprise d’une illusion de maîtrise, contraire à notre condition moderne.
M. Abensour avait bien formulé la question il y a déjà quelques années :
il y a chez Schürmann, disait-il, une nouvelle conception de la pensée du politique, qui se contenterait de situer et non de fonder. L’agir y est à lui-même sa propre fin, et le politique se contente d’exposer le principe, d’être un lieu d’entrée dans l’événement, de la présence donc comme histoire, à l’écart de toute domination par les fins13.
Mais les propositions schürmaniennes ne sont pas pour autant décontextualisées. Ainsi, il analyse clairement les formes de gouvernementalité néolibérale, montrant en quoi celles-ci lient une atomisation individuelle et une soumission à l’État, liens organisationnels et atomistiques étant inséparables ; mais dans l’opposition à ces formes, il distingue entre individualisme et anarchisme, et son « sujet an-archique » est du côté de l’individu ; il se constitue, dit-il, « à travers des micro-interventions dirigées contre les configurations récurrentes de sujétion et d’objectivation14 ». Il s’agit pour lui, au mieux, de « combats an-archiques », c’est-à-dire dispersés, polymorphes, qui ne sont surtout pas dirigés contre des forces plus institutionnalisées.
Ce qui pose un triple problème :
– Sa posture en revient à ignorer ou refuser toute dimension collective des luttes. Le problème n’est pas d’essayer de libérer les individus de l’État, mais de nous libérer nous du type d’individualisation qui se rattache à l’État, ce qui est un travail d’un autre type (qui pourrait du reste se dire, en langage plus classique, « se défaire de l’imaginaire de la nécessité de la domination »), mais qui, selon lui, semble exclure le registre des luttes politiques collectives.
– Ensuite, l’anarchisme est pour lui « un moyen d’interventions discursives », c’est-à-dire une contestation de notre insertion dans des dispositifs de discours et de pouvoir. On lutte plus contre des dispositifs, des « effets » de pouvoir, que contre les institutions et personnes les mettant en œuvre dans des rapports de force. Il est notable que Schürmann note comme possibles insertions tous les lieux de vie quotidienne (domestique, corps, santé, folie, genre, etc.), tout, sauf les institutions, groupes ou personnes qui incarnent de manière plus institutionnelle l’État ou le capitalisme, et qui se réfèrent au travail, au social.
– Toute idée de prise sur le réel est pour lui ce dont il faut se défaire ; la maîtrise (y compris de soi) n’est pas un but, mais un obstacle, car elle se situe dans les formes sociales existantes, et imaginer un autre système revient, dans cette pensée, à augmenter notre intégration au système présent.
Les luttes anarchiques ne doivent donc pas briser des totalités (pourtant elles existent encore) mais plus essentiellement leur nature polymorphe, sporadique, transversale, immédiate. Donc les luttes doivent en rester au niveau individuel, ou « micro », mais sans nécessité aucune de passer au « macro », qui n’est vu que comme piège et écueil. Or nous savons que le système a toujours su supporter des poches, des lieux à la marge qui constituent des ailleurs non dérangeants pour lui.
Par contraste avec l’anarchisme du XIXe siècle, dit-il, celui qui reste possible aujourd’hui reste plus pauvre, plus fragile. La seule possibilité, c’est de laisser les choses se mettre en présence, dans des constellations essentiellement rebelles à l’ordonnancement.
La critique que M. Abensour avait formulée à ces conceptions, c’est que l’agir y est rendu à lui-même, s’ouvrant ainsi à la libre aventure… pour le meilleur ou pour le pire. Cette simple valorisation de l’agir ouvre en effet à tout, pourquoi faire telle chose plutôt qu’une autre ? Le XXe siècle est rempli « d’agirs an-archiques », qui ont entraîné les pires catastrophes. Et l’expérience de liberté peut toujours se retourner en servitude. « Si l’agir devenu anarchique est rendu à lui-même – redevient sa propre fin – peut-il s’engager dans une autre direction que celle d’un régime libre15 ? » C’est une des nombreuses interrogations laissées ouvertes par les « praxis an-archiques ».
Du reste, à quel anarchisme fait écho cette an-arkhè vue par les philosophes de la déconstruction comme « principe de l’absence de principe » ?
Quelles conceptions de l’anarchisme ?
Il semble que les philosophes de la déconstruction aient souvent une approche substantialiste et simplificatrice de l’anarchisme, ignorant la diversité de ses courants, voire les clivages. En effet, la conception du sujet à laquelle il est fait référence dans ces travaux, c’est, en contrepoint, le sujet « moderne », surplombant, qui objective le réel. C’est par rapport à cette figure, qui est à leurs yeux celle de l’illusion rationaliste, que ces philosophes font émerger la figure du sujet an-archique.
Or, ce sujet dominateur existe-t-il dans l’anarchisme, et même ailleurs que dans les fantasmes des postmodernes, qui se réfèrent à un cartésianisme dix-septiémiste remis en cause depuis longtemps ?
Bien avant Foucault, les auteurs du XIXe siècle, les « philosophes du soupçon »16 ont théorisé l’aliénation, la fausse conscience, la non-coïncidence à soi, sans compter les apports de la psychanalyse et des sciences sociales. Cette vision de la « superbe » du sujet semble bien passéiste et figée, d’autant plus que depuis 1968 ces conceptions se sont élargies avec la prise en compte des formes d’autorité qui irriguent tous les secteurs de la vie quotidienne et sociale, entraînant une extension des terrains de luttes et des formes de pensée, et relativisant tant les conceptions classiques du sujet que celles de l’action politique (vie quotidienne, femmes, écologie, etc.)17.
Mais pour ces philosophes post-structuralistes, la façon qu’aurait l’anarchisme de refuser tout fondement supposerait malgré tout, en arrière-plan, un « au-delà » d’une bonne et vraie nature, une fois la désaliénation effectuée, donc une pureté originaire sur lesquelles se fonderait l’illusion d’une action maîtrisée. Il y aurait l’idée d’une innocence retrouvée une fois le pouvoir et ses méfaits vaincus.
Or, les anarchistes n’ont pas en arrière-plan l’idée d’une vérité de soi retrouvée, une fois l’idéologie éliminée. Ils n’ont pas d’idée d’une « bonne » nature humaine ; pour eux, la nature peut être bonne ou mauvaise, selon les formes de socialisation et les circonstances qui ont forgé une personne. Il n’y a pas dans l’anarchisme de sujet « inconditionné », essentiel et identique à lui-même.
Ce reproche fait à l’anarchisme d’en être resté à une conception archaïque de la « nature humaine », à l’humanisme, s’inscrit dans celui plus général d’en être resté au stade métaphysique, c’est-à-dire de s’inscrire dans la nécessité d’un référent dernier, puisqu’il substituerait au pouvoir d’autorité le pouvoir de la raison, et resterait prisonnier de son attachement à la science. Il en resterait à la surface du problème, remplaçant un fondement par un autre, au lieu de l’abolir. Bref, il croirait encore à l’homme, à l’émancipation par la connaissance et la raison. Il parachèverait la modernité et serait donc anachronique, il témoignerait de son inachèvement.
Or le « sujet » des anarchistes n’est pas cette caricature de sujet moderne18. Il n’est pas un sujet unifié, fixe, homogène. Il est multiple, changeant, hétérogène, construit et collectif. Les êtres sont aussi une résultante des transformations dues aux rapports entre eux, c’est-à-dire le fruit de l’éducation, des situations. Il n’y a donc pas d’essence, bonne ou mauvaise de l’homme, ce qui est reproché ici. Tout est perpétuellement construit, la conscience, les perceptions. Comme le disait Marshall Sahlins19, la nature de l’homme, c’est d’être un être symbolique, c’est la culture.
Par contre on retrouve bien dans l’anarchisme un héritage des Lumières radicales, car elles sont libératrices dans leur opposition aux dogmes, à la foi, à la révélation, elles démystifient. Et la raison comme la science sont aussi une condition du changement social ; ce qui n’équivaut pas au pouvoir de la science. Pour les anarchistes (toujours au pluriel) la connaissance est toujours imparfaite, et la vie toujours en devenir. L’expérience, l’art sont reconnus du reste comme étant tout autant sources de connaissance, car habiter un monde, c’est aussi le « savoir » dans de multiples dimensions. Bref, rien n’est absolutisé, et plus que la rationalité dominatrice et sécurisante décelée par les postmodernes, on trouve les idées d’altérité de collectif, et de solidarité.
L’anarchisme n’a donc pas grand-chose à voir avec ceux qui dénoncent le subjectivisme moderne au nom de l’Être de Heidegger, concluait V. Garcia20.
C. Castoriadis et la critique de l’ontologie heideggerienne
Tout en situant sa philosophie dans le trait fondamental de la condition moderne, l’absence de tout fondement et référents derniers, C. Castoriadis reste en marge du déconstructionnisme, du postmodernisme et du nietzchéisme21. Il a consacré de nombreuses pages à la critique de Heidegger et aux conséquences de sa pensée sur la vision du politique et ce qui nous intéresse ici, c’est que sa philosophie déplace l’approche de la question de l’être, et donc celle de l’histoire et du politique.
La pensée philosophique de Heidegger, dit-il, fait de l’être une pure présence, et de l’homme un sujet qui transforme en objet ce qui est posé face à lui et en vise la maîtrise ; l’histoire se réduit alors à l’arraisonnement de toute chose par et pour l’homme22. Castoriadis rejette cette thèse heideggérienne qui fait de l’être l’expérience originaire de notre présence au monde. Il se situe à l’écart de cette problématique ancrée dans la question du fondement, de l’origine. Il reproche à la philosophie de la déconstruction, au-delà de son apparente radicalité dans la critique du « principe premier », d’être restée contre-dépendante des problématiques de la déterminité, c’est-à-dire d’être toujours hantée par la question des causes premières, voyant dans tout énoncé le retour possible de dangereux référents, et oublieuse du fait que « le monde est déjà toujours là ».
Il reproche à Heidegger de manquer totalement deux dimensions fondamentales de l’être, celle de la création, et celle du social- historique.
Pour Castoriadis aussi l’être est temps, mais cela signifie qu’il est animé par une puissance de création ontologique, qui émerge du « chaos originaire, de l’abîme » sur lequel nous sommes comme posés, il est surgissement. À partir de là, il va développer une ontologie du mode d’être propre au « social-historique ».
Il est en désaccord avec Heidegger sur l’interprétation de la philosophie grecque ; la question que pose cette philosophie n’est pas selon Castoriadis, « qu’est-ce que le sens de l’être ? » mais « que pouvons-nous penser, de l’être, de la polis, de la justice et de notre propre pensée ». Et pour qu’une question comme : qu’est-ce qui fait que quelque chose est ? puisse se poser, dit-il, il faut une rupture dans la clôture de l’institué23, et la liberté est créée dans et par la position de cette question. C’est-à-dire que s’inaugure là un questionnement continu qui correspond à la naissance de la philosophie et rend possible la démocratie comme mise en question de l’institué.
En conséquence, proclamer la fin de la philosophie comme le fait Heidegger, c’est affirmer la fin du projet social-historique de la liberté et de l’autonomie ; c’est aussi l’oubli de l’être social de l’homme. Le résultat de cette restriction heideggérienne est alors l’impossibilité de toute réflexion politique et éthique.
La question posée par Castoriadis, en radicale opposition au point de vue heideggérien, est celle de savoir quelles sont les conditions de possibilité du projet d’autonomie individuelle et collective. C’est en partant de là qu’il développe sa conception de l’irruption de l’imaginaire instituant, dans et par l’activité d’un collectif anonyme, c’est-à-dire la capacité à rompre la clôture des significations imaginaires sociales instituées24. Ce qui revient à dire que pour lui, avec la démocratie, on assiste à la possibilité d’une rupture de l’hétéronomie sociale, et « la création d’un nouveau type d’être, la subjectivité réfléchissante et délibérante, c’est-à-dire la création d’un nouveau type de discours, le discours philosophique, qui incarne l’interrogation illimitée et se modifie lui-même au cours de son histoire »25. Pour dire les choses autrement, sa conception du chaos originaire, mais aussi de la création social-historique, préserve sa pensée de tout arkhè, mais ouvre la possibilité de la mise en place d’une forme politique dont le contenu reste ouvert.

Castoriadis notait il y a trente ans déjà que la pensée déconstructionniste est un symptôme de la crise actuelle de la critique, et se prolonge comme logiquement par la mort du sujet.
En regard de la philosophie de Heidegger, l’approche de Castoriadis déplace considérablement la question de la pensée de l’être en restaurant une dimension social-historique, respectueuse du « sans fond » sur lequel nous campons, mais préservant une dimension d’imagination, de création, et un agir politique, lucide sur le fait que les clôtures de l’institué tendent toujours à se refermer, et donc que la lutte contre la domination est permanente.
Quelles conséquences sur la conception du politique ?
Les analyses déconstructionnistes de l’an-arkhè se terminent sur le constat d’une impasse en ce qui concerne l’anarchisme politique. « L’anarchisme politique n’aura eu aucune chance dans la déconstruction » en convient C. Malabou puisque « le déni de l’anarchisme serait ainsi la condition sine qua non de son affirmation ». Nous ne sommes pas loin de penser qu’il y a dans tout cela un peu de coquetterie intellectuelle…
N’y a-t-il pas chez ces philosophes une assignation de l’anarchie à l’ontologie, qui pour être fidèle à elle-même ne pourrait être que nihiliste ? En effet, la leçon politique que tire C. Malabou26 est que l’anarchisme ne peut être que le non-gouvernable, ce qui est différent de l’ingouvernable, de la contestation, de la transgression, mais quelque chose comme une altérité pure, un ailleurs inatteignable, une étrangeté radicale, à l’écart de tout. Car dans cette course à « l’impossible origine » on se trouve toujours à un moment confronté à la question de savoir « qu’est-ce qu’il y a avant une origine qui n’en est pas une ? » Et la réponse proposée par C. Malabou renforce le piège du nihilisme qui guette ces conceptions. S’il n ‘y a rien à l’origine, cela revient à dire qu’il faut inventer, nous dit-elle. Certes. Mais on rencontre là le problème de « la nouveauté pour elle-même », comme procédé et fuite en avant. L’invention comme principe, sans valeurs ni sens de l’autolimitation, c’est possiblement la porte ouverte à des aventures mortifères (rappelons que les totalitarismes voulaient tous faire l’homme « nouveau »). Rien ne permet de discriminer entre tous les « agirs » possibles.
Du reste, elle voit aujourd’hui à l’œuvre deux anarchismes, l’un qu’elle appelle « d’éveil », les actions anarchistes militantes, l’autre l’anarchisme « de fait », qui recouvre aussi bien le bitcoin que les libertariens ou l’anarchie trumpienne. Si l’on écarte ces prolongements douteux, cette approche ontologique de l’anarchisme ne permet pas de discriminer entre les luttes contre la société existante et le libertarianisme qui gouverne de plus en plus le monde. Ce « non gouvernable », s’il ne fait pas signe vers les multiples et imprévisibles résistances à la domination, s’il est simplement conforme à une absence d’origine, de principe, renvoie « au rien qui précède le rien », à l’inorganique, au mortifère, au retrait, au néant… or la réalité du néant, c’est, sans mauvais jeu de mots, le « né en… », quelque chose comme un surgissement dans la dimension du social-historique, une brèche dans l’institué, et l’on retrouve là le déplacement castoriadien de la question. Comme le dit E. Jourdain, « il existe une grande différence entre le passage du Néant à l’Être qui suppose une cause première et une création par Dieu, et le passage du désordre à l’ordre qui suppose que le monde est toujours déjà là »27.
Le plus conséquent alors, pour ces post-heideggériens, est peut-être d’entériner la rupture entre an-archie et anarchisme, et d’en rester à une position éthique.
D’autres philosophes, différents entre eux, mais dont le point commun est de ne pas se situer dans le champ conceptuel de la déconstruction, permettent de penser la question de l’action politique, de la liberté et du collectif. Ils ne se revendiquent pas de l’anarchisme historique qu’ils critiquent même, mais ils nous offrent des pistes pour penser ce que peut être une démocratie radicale, libertaire, refusant tout principe fondateur ou ordre positif, et mettant en avant le travail du négatif qui a partie liée avec la liberté.
Ainsi Claude Lefort, partant du constat de la perte des repères de la certitude, de l’indétermination qui préside au politique, de la disjonction du savoir et du pouvoir comme traits spécifiques de notre condition moderne, construit l’idée de démocratie sauvage, comme conception libertaire d’une démocratie radicale28. Il voit dans la dissymétrie du désir des Grands (dominer) et du Peuple (simplement ne pas être dominé) la source d’une résistance aussi permanente qu’imprévisible à l’oppression.
C. Castoriadis mettant au cœur de sa pensée l’absolue contingence de tout ce qui est institué, l’arbitraire des significations allouées aux valeurs, fait de l’autonomie comme capacité de rupture de ce qui est institué le trait fondamental de la condition politique moderne, préservant l’ouverture aux possibles, avec tous les risques qui lui sont liés.
Quant à Miguel Abensour, instruit par sa fréquentation des penseurs de l’école de Francfort des risques de retournement en leur contraire des luttes pour l’émancipation, et voyant la modernité comme inaccomplissement essentiel de toute chose, il développe une pensée de « l’insurgeance », comme moment privilégié d’une démocratie vivante.
Dans ce cadre, comme le dit Édouard Jourdain, « l’anarchie peut alors être considérée dans son irréductibilité radicale à partir de laquelle la liberté comme action trouve son inépuisable force »29.
Ces trois auteurs inventent des formes politiques compatibles avec une philosophie de l’an-arkhè ; elles nous écartent de l’écueil du nihilisme et se situent dans l’horizon d’une démocratie libertaire, conçue comme une forme de lutte permanente contre l’institué, et animée par le souffle de la liberté.
Pour ne pas conclure
Castoriadis notait qu’un des éléments de la crise actuelle était l’atrophie du conflit et de la critique. Les travaux récents contribuent-ils à réarmer la théorie critique ?
Si le post-structuralisme a semblé refléter intellectuellement certaines des préoccupations de l'anarchisme (en tant que philosophie) tout en devenant intellectuellement dominant, la lecture de l'anarchisme à travers une lentille post-structuraliste semble déboucher au mieux sur le scepticisme ou, pire, sur le nihilisme, et sa limitation au présent, au maintenant, sa perception d’un temps vide de sens risque de condamner l’anarchisme à n’être alors qu’une bulle hors du temps et de l’espace.
Or « nous avons besoin d'intellectuels qui réfléchissent de manière créative, sans déconfigurer toute ambition dans une niche éphémère de théorisation hyperfocalisée, où tout n'est que pour l'ici et le maintenant »30.
Nous avons besoin d'une réflexion soutenue dans une perspective d’émancipation avouée qui rappelle l'importance de la liberté et qui cible clairement les lieux et formes de domination dans le néo-libéralisme qu’est le capitalisme actuel.
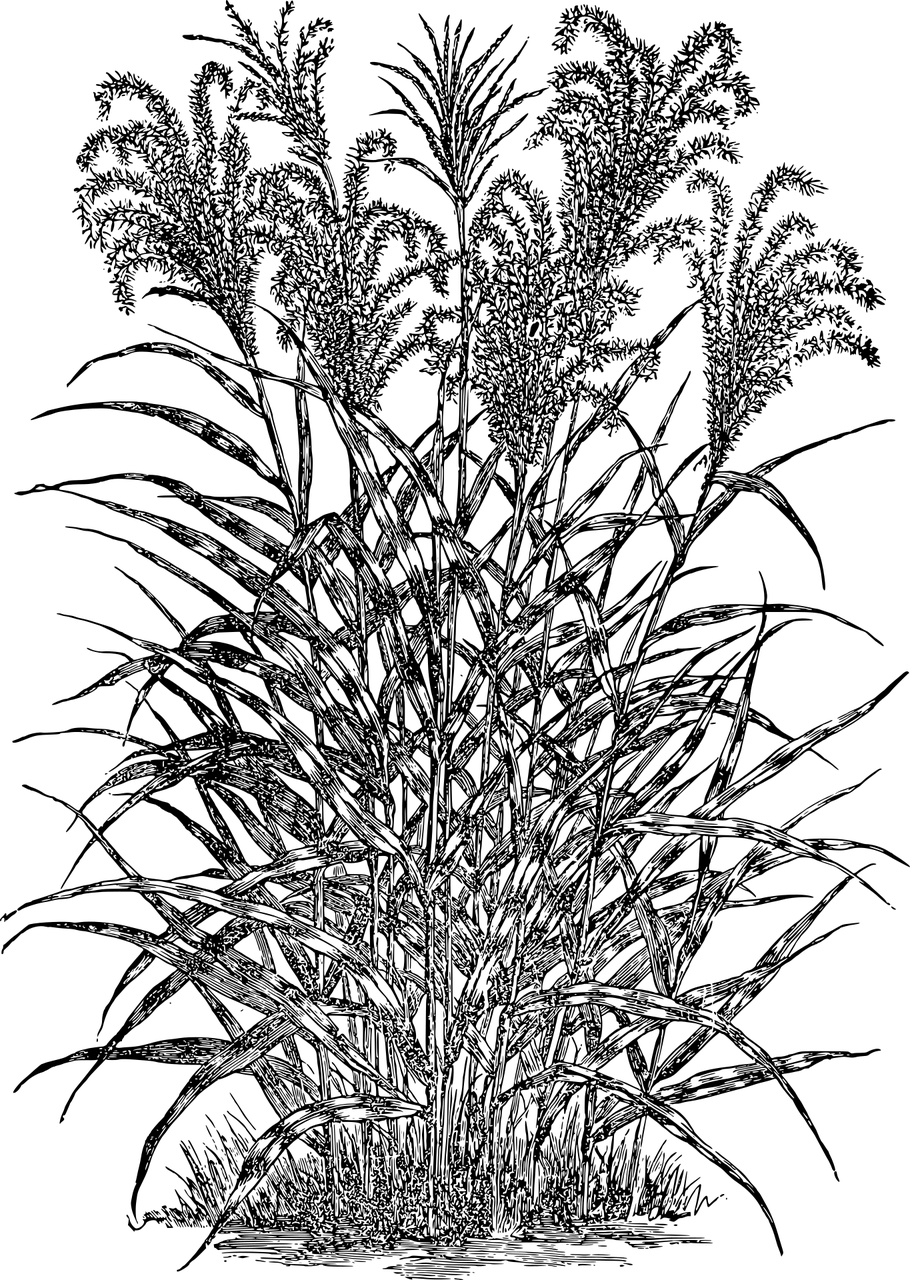
Comme le proposait récemment F. Gomez :
C’est pourquoi, aux déconstructeurs qui veulent s’en défaire, il convient d’opposer, pour réarmer la théorie critique, un retour aux “Lumières radicales”. Sans réappropriation de ces “Lumières radicales” et de la pensée critique qui les prolongea, il est fort improbable que la question de l’émancipation sociale, humaine, anti-technologique – qui pourtant pointe à travers tous les combats de notre temps sans repères – fasse fondement d’une perspective globale de transformation31.
En d'autres termes, nous devons passer un peu plus de temps à penser en critiques et en anarchistes, « sans dogmes » certes comme dit Tomás Ibañez, mais avec quelque boussole ou rose des vents.
Vers un anarchisme post-fondationnel largement irrigué par ses confins Sur l’autonomie en mouvements
