À quoi bon être anarchiste ?
À quoi bon être anarchiste ?
Marianne Enckell
Il fut un temps où l’anarchisme était une idée simple et claire, où les journaux étaient accessibles à chacun-chacune, où les intellectuel·les parlaient simplement aux compagnes et compagnons, où la culture était un outil d’émancipation. On faisait partie d’un groupe au nom ronflant, on distribuait des tracts, on était anarchiste (avec mille nuances) et pas suspect·e de confusion avec d’autres courants.
Les quelques anarchistes qui avaient eu une formation académique n’en faisaient pas carrière, à l’instar de Bakounine, Kropotkine ou Reclus. De rares historiens et juristes ont publié des thèses dans la première moitié du XXe siècle, mais ils n’étaient en rien anarchistes. Les militant·es étaient pour la plupart autodidactes, ils couraient les conférences et autres universités populaires où l’on débattait de science positive, de laïcité, d’éducation. Le bagnard Clément Duval accompagne un astronome français lors d’une expédition en 18891 : « Sachant que j’étais anarchiste, nous eûmes des entretiens de sociologie dont il était ignorant. » À côté des « classiques », peu nombreux au demeurant, les bibliothèques des groupes ou des personnes2 contenaient en effet des ouvrages de sociologie, de sciences ou de philosophie matérialiste. Connaître, c’est être libre ; savoir, c’est pouvoir ; acquérir le savoir et conquérir la liberté permet de se passer du gouvernement et de l’État.
Avec ces idées simples, on n’avait évidemment pas réponse à tout.
Après la deuxième Guerre mondiale, des revues comme Volontà en Italie (1946-1995) ou Anarchy en Grande-Bretagne (1961-1970) ont approfondi les questions contemporaines, faisant souvent appel à des auteur·es qu’elles considéraient comme proches de leurs idées anarchistes ou pouvant susciter ouverture et réflexion. Politique internationale, sociologie des élites et de la technobureaucratie, contrôle des naissances, situation des travailleurs méridionaux côtoient dans la première des articles plus classiques de la tradition anarchiste. Elle a en commun avec Anarchy un intérêt pour l’architecture et l’urbanisme, l’éducation, les théories de Wilhelm Reich, les luttes des colonisé·es notamment. Anarchy, peu redevable aux grands ancêtres, se penche aussi sur les prisons, la culture, la sexualité. Grèves et mouvements sociaux y trouvent moins de place. Les théories anarchistes rajeunissent, s’adressent à un nouveau public.
La voie des études supérieures a commencé à s’ouvrir, à se démocratiser ; les « classes moyennes », comme on dit, accèdent à la télévision, au théâtre, aux livres de poche – voire à des ouvrages anarchistes. Après Mai 1968, l’université a en quelque sorte gagné la partie, beaucoup de militant·es en sont issu·es. La question du communisme et de l’URSS reste très présente dans les débats, anarchistes ou non, comme le montrent deux entretiens dans ce numéro de Réfractions. Peu d’années plus tard, la vague de désindustrialisation couplée à celle de la mondialisation néolibérale et à la chute du Mur fait encore fondre le nombre d’ouvrières et d’ouvriers dans les syndicats et les collectifs militants.
Le pas de côté
Au XXIe siècle, le tableau se nuance. Un florilège.
On est, pour la plupart, de cette génération qui a été envoyée à la fac pour faire baisser les chiffres du chômage, et qui n’a jamais eu en guise de travail que des petits boulots. […] Nous étions nés avec la conscience aiguë des désistements brutaux de la génération des années soixante-dix et étions nous-mêmes enfants de cet individualisme moderne qui cherche constamment à conserver la possibilité de se désengager et de tracer sa route.
Ce sont des personnes du collectif Mauvaise Troupe qui se présentent ainsi. Elles et eux ont parcouru la France il y a une dizaine d’années pour rencontrer compagnes et compagnons qui sont sortis du système mortifère, et pour faire un livre « de cette kyrielle d’expériences qui viennent reposer la question révolutionnaire ». Leurs textes, entrevues, témoignages et commentaires ont été réunis sous le titre de Constellations3.
En France comme ailleurs, les militant·es du « jeune XXIe siècle » – y compris celles et ceux qui vivent dans les cabanes des ZAD, qui sèment des carottes, bloquent les convois nucléaires, sabotent le travail, partent pour le Chiapas ou le Rojava – ont lu quantité de livres, d’articles, de pdf d’intellectuels de haut vol. Elles et ils en font parfois des petits pâtés appétissants, parfois des hochepots ou des arlequins. La rédaction du journal d’intervention Rebetiko : chants de la plèbe confesse :
Je ne dirais pas qu’on partait d’un corpus bien défini. Notre pensée, c’était pas une liste fermée de concepts, les influences étaient relativement diverses et variées. Si on doit parler de l’influence radicale type Insurrection qui vient, Badiou, Brossat, Agamben, Tiqqun et Cie, c’est sûr que ça nous a marqués… Après, c’est un courant assez large, qui brasse Foucault, Deleuze, on peut aller chercher jusqu’à Spinoza si on veut. Mais on ne piochait pas que dans ce courant-là, il y avait d’autres influences, de René Char à Os Cangaceiros.
La Mauvaise Troupe qui s’est entretenue avec Rebetiko et des dizaines d’autres ne juge pas nécessaire d’indiquer des références en note, ses lectrices et lecteurs connaissent évidemment tous ces noms, même si souvent ils n’en ont pas lu beaucoup de pages. Mais ils n’ont pas lu non plus Volontà ou Anarchy.
Plus récemment, c’est en Suisse que le collectif Nous sommes partout s’est entretenu avec des personnes engagées dans des luttes parfois similaires, souvent marquées par l’air du temps4.
Centré sur l’expérience de l’action politique radicale, Nous sommes partout ne se structure pas autour de perspectives idéologiques prédéfinies. […] Nous essayons de rester très prudenxtes avec les étiquettes, parce que les mots désignent des réalités différentes selon les personnes, les histoires individuelles, les imaginaires, les villes, les pays, les terrains, les idéologies ou les vocabulaires de référence.
Cela implique notamment une écriture inclusive réfléchie et systématique, détaillée dans la présentation des principes typographiques.
Un millier de pages à lire pour ces deux volumes (il y a quelques illustrations), et ce ne sont là que des échantillons, qui en disent long aussi sur les choix des enquêteurs et enquêtrices. Ailleurs, sans doute, le tableau est ressemblant, même si c’est dans des conditions bien différentes. Celles et ceux à qui les recueils donnent la parole ont fait un pas de côté, comme le proposait Gébé il y a un demi-siècle5 : « On nous dit le bonheur c’est le progrès, faites un pas en avant. Et c’est le progrès, mais ce n’est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté ? Si on essayait autre chose ? » Troc ou fauche, plantation de vergers et ateliers collectifs, échanges de savoirs, journaux gratuits, écoles alternatives, collectifs de sans-papiers et collectives féministes, zads et cantines, spectacles et fêtes, on peut s’essayer à tout – parfois en vivant sans honte sur les aumônes de l’État.
Lorsque nous voulons créer des alternatives et que nous voulons militer ensemble et horizontalement, il nous faut nous réinventer, apprendre des nouvelles formes d’écoute et de partage. Dans l’autogestion anarchiste ou autonome, il ne s’agit pas de créer des espaces sans règles et sans cadres, mais de construire et d’organiser des alternatives qui permettent une répartition des pouvoirs, des tâches chiantes, des tâches valorisantes. Il s’agit d’inventer des outils qui ne sont pas imposés par des patronnexs, des cheffexs, des États et des polices, mais qui sont créés par le bas, par touxtes, des outils amovibles et mouvants et non des lois gravées dans le marbre.
Les exemples venus de France sont très souvent liés au territoire, à l’habitat. « Habiter, c’est vous rendre ingouvernable », disent plusieurs voix : ça n’est pas très sérieux, ignorant largement les conditions de location ou d’accès à la propriété, et les tentacules de la gouvernabilité…
Vignes d’un mas du Lubéron, ferme du Hayon belge, village ardennais, troglodytes, ékluserie rennaise, villa genevoise occupée, traverse grenobloise, gargantuesque friche d’usine automobile à Lyon, cantine dans un quartier prolo stéphanois, blocs de bétons des Tanneries… Notre manière d’arriver dans les lieux et de les habiter momentanément dressait petit à petit une cartographie amie qui permettait de sentir chez soi en de multiples points.
Ils s’inscrivent aussi dans la légende ou l’histoire locale.
Il y a [dans la Creuse] un imaginaire historique : la politisation des maçons de la montagne limousine, des scieurs de long, les vagues successives d’immigration, le soviet de la Courtine, les brigades internationales qui passent par ici, le communisme rural d’avant-guerre, le maquis à la Guingouin, des gens d’un village qui arrêtent un car d’appelés pour la guerre d’Algérie, la vague post-68, du moins ceux qui n’avaient pas assez d’essence pour descendre en Ariège (rires), etc. Oui, oui, il y a une mythologie locale.
Certain·es ont fait partie de groupes anarchistes, d’autres s’y connaissent, se considèrent comme anarchistes, n’apprécient pas toujours : « Découverte palpitante : des anarchistes essayaient déjà d’imaginer un service public sans l’État il y a plus d’un siècle (« Privés, publics, communs, quels services ? », Réfractions n° 15, hiver 2005) ! Je tente la lecture et suis vite dégrisée par des pensées laborieuses, prétentieuses, techniciennes… » Ils sont plus nombreux à se qualifier d’autonomes ou de radicaux. C’est dans la partie intitulée S’organiser sans les organisations, qui ne recule pas devant l’autocritique.
Je crois que ma désaffection pour le syndicat est arrivée avec ce bête constat : rien de ce qu’on y faisait d’intéressant ne nécessitait de le faire au nom d’une organisation. Collectivement, oui.
Quand « nous voulons tout », que « nous sommes fières et fortes et en colère » et que « seule la lutte paye », je trouve cette radicalité. Ces slogans me sont familiers, ils sont dans le top ten du bréviaire de l’anarcha-féministe. Mais derrière les slogans se dessinent des objectifs beaucoup plus pragmatiques : obtenir des papiers pour Meïssoum avant de s’attaquer au problème de son appartement insalubre, acquérir un meilleur logement pour Maïssa, Aylin, Fabinta, Thioumbane, Denise et Raza, empêcher l’expulsion de Florence et aider Yasmina à rester chez elle avec son plus grand fils contre l’avis du reste de sa famille. Et pour toutes, pouvoir simplement vivre tranquillement. La radicalité, est-ce prendre les choses « à la racine », penser les bases du système ? Ou bien partir de nous, de ce qui nous préoccupe intimement ? Sans doute les deux.
Est-ce un hasard si les paroles de femmes sont les plus lucides, les plus explicites ?
Je suis tombée dans le chaudron de la radicalité et de la militance à 17 ans, quand j’ai déménagé à Saint-Imier. Dans ce bled, il y a un des plus vieux centres anarchistes d’Europe. J’y ai passé sept ans à bouffer pas mal de littérature et à faire des actions. C’est venu naturellement. Enfin, je ne me suis pas réveillée un matin en me disant, hmm, je vais devenir anar’ et féministe. De par mon entourage et par la seule structure intéressante du bled, j’ai mangé tout ça. C’était logique, c’était radicalement plus à gauche que de m’inscrire dans un parti. Quelque chose de beaucoup plus concret. À partir de là, la suite a été logique : déménagement à Lausanne, fréquentation d’endroits alternatifs, de squats, de l’Espace Autogéré.
Les collectifs ne sont pas toujours durables, ils se constituent en réseaux, en rhizomes – jolie image à la mode deleuzienne. Ils sont volontiers nomades, il se peut que les enfants germent ailleurs, ou autrement. Leurs publications arrivent aussi ponctuellement à la bibliothèque du CIRA – qu’ils se disent proches des anarchistes ou non.
Inspirations
Jean-Christophe Angaut notait, dans un numéro précédent de Réfractions, qu’« une partie non négligeable des militant.es libertaires étayent aujourd’hui leurs engagements sur des références philosophiques ou académiques plutôt que sur la tradition anarchiste »6. Mais tant les militant·es que les essayistes partent de situations et d’expériences actuelles, vécues, pratiques. Cette revue en a cité d’abondance. Ils ne se donnent guère d’étiquette, d’ailleurs : chacun·e propose des concepts, voire des solutions à la crise ou des programmes révolutionnaires. Un des intervenants récents dans ces débats est Jérôme Baschet, aguerri par l’expérience zapatiste7.
Il convient […] d’assumer une extrême diversité des espaces libérés, depuis les amples régions autonomes du Chiapas ou du Rojava jusqu’aux expériences micro-collectives, qui ne sont pas moins importantes. […] s’y expérimentent et s’y fortifient (au moins) trois ingrédients indispensables à un possible basculement généralisé : l’expérimentation des arts difficiles du faire-commun, la maîtrise de multiples savoir-faire techniques, l’amorce d’un basculement anthropologique permettant de défaire les normes du naturalisme et de l’individualisme. […] C’est la détérioration des conditions de vie (pour ne pas dire la croissante destruction des mondes) provoquée par la dynamique de crise systémique qui rend plus désirable l’expérimentation des espaces libérés, en même temps qu’elle rend plus urgentes les pratiques de blocage et peut conduire au point de rupture des digues de contention de l’intolérable.
Tout comme plusieurs autres auteur·es, ceux par exemple publiés dans Réfractions n° 45 sur la « démocratie sauvage », Baschet ne se déclare pas anarchiste mais ne rechigne pas à participer à des réflexions communes. Tous parlent de s’organiser sans État, du moins sans institution séparée, sans hiatus entre gouvernants et gouvernés. Ils préfèrent toutefois employer les termes d’autonomie, d’auto-gouvernement, de communes et de communs, de démocratie directe. Ils ont sans doute lu (un peu) Proudhon, Bakounine et Kropotkine tout comme Marx, mais c’est rarement ceux-là qu’ils citent. Pourtant, quand Jérôme Baschet évoque l’« auto-gouvernement des communes », ne reprend-il pas une notion largement développée il y a un siècle et demi par Michel Bakounine, James Guillaume et Adhémar Schwitzguébel, entre autres ? Ce dernier oppose à l’État le groupement réuni par un « pacte fédératif consciemment établi et librement consenti »8.
Cette idée de l’autonomie fédérative comme principe organique de la société humaine a reçu sa sanction pratique par le soulèvement du peuple de Paris au 18 mars 1871 et par les tentatives insurrectionnelles qui ont eu lieu à cette époque dans diverses villes de France ; le prolétariat de tous les pays a non seulement acclamé le fait révolutionnaire mais l’idée qui s’est manifestée dans ce fait, et aujourd’hui toute révolution réellement populaire se fera au cri de : Vive la Commune libre !
Ni le principe ni l’expression ne sont propriété des anarchistes, bien entendu. Il n’en reste pas moins que certain·es essayistes actuels traitent les idées anarchistes par le dédain ou, à l’inverse, les instrumentalisent pour bâtir une carrière académique. Le retour aux sources n’est jamais superflu.
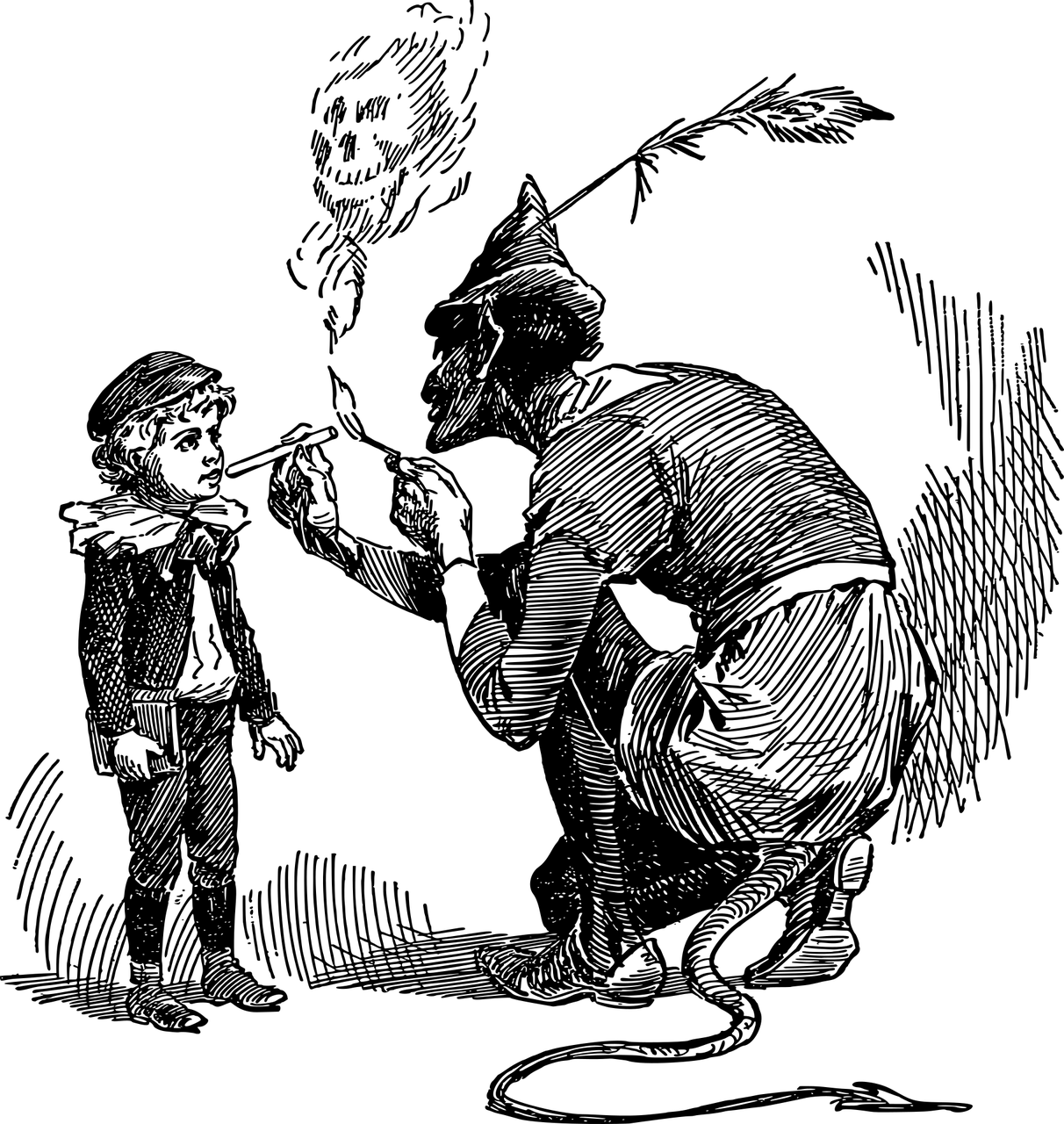
Alors, toujours anarchistes ?
En proposant l’idée de cet article au collectif de Réfractions, j’ai eu quelques appréhensions : allais-je aussi finir par me demander à moi-même « À quoi bon ? » Compagnes et compagnons m’ont encouragée et soutenue, j’ai dû aller de l’avant. « Anarchiste, et fier de l’être », affirmait Amedeo Bertolo il y a quelques années9. Fièr·es de s’inscrire dans une histoire courageuse, difficile, chaotique souvent, sans concession avec le pouvoir et ses institutions. Fièr·es de partager le refus de parvenir, la solidarité des copains-copines, de cultiver les différences dans l’égalité.
Récemment, deux universitaires écossais, découvrant par hasard un recueil pauvrement dactylographié des années 1980, traduit en anglais de la revue italienne Volontà, sont tombés des nues : quoi, une série d’auteur·es anarchistes totalement inconnu·es qui réfléchissent, qui renouvellent les analyses ? Sur-le-champ, ils ont revu les traductions et publié ce recueil chez un éditeur académique, assorti d’une solide introduction10.
L'intérêt que nous portons à ces essais réside dans la manière dont ils abordent certaines des questions essentielles de la recherche contemporaine en sciences sociales et humaines sous un angle rarement, voire jamais, publié. Comment penser l'État en tant que mode de pouvoir plutôt qu'en tant que « chose » sans que le « pouvoir » ne soit dévolu qu'à nous-mêmes ? Comment l'autorité est-elle intériorisée par ceux qui sont soumis à la volonté des autres ? Comment expliquer les origines du patriarcat ? Ce ne sont pas des questions « anarchistes » en soi, mais y répondre d'un point de vue qui refuse de remettre fondamentalement en question, entre autres, le pouvoir de l'État, l'institutionnalisation de la domination, le lien entre l'oppression sexuée et l'autorité elle-même, etc., n'offrira toujours que des réponses partielles. Dans la mesure où toutes ces questions recoupent une grande partie de la pensée influente du XXe siècle (Foucault, Baudrillard, Negri, Butler, la « nouvelle gauche », etc.), il est grand temps de prendre au sérieux la contribution anarchiste à ces débats.
Voilà qui nous réconforte. Que ces éditeurs soient anarchistes ou non, peu importe ici. Qu’il s’agisse d’enseignants universitaires, tant pis (s’ils sont aussi militant·es, tant mieux) ; reste à espérer que la lecture de ce recueil ne se limite pas aux auditoires académiques.
À n’en pas douter, l’anarchisme et les anarchistes vont continuer d’évoluer, de muter, de muer. Que ce soit dans une direction post-structuraliste ou post-moderne, vers des formes nouvelles de syndicalisme d’action directe, par la construction de fédérations rhizomiques, dans mille et une expériences et réalisations collectives. En rêvant de prendre le Palais d’hiver, le Central téléphonique ou le siège de Monsanto, mais pas le Capitole. Avec, aussi, des compagnes et compagnons qui se situent aux confins, qui cherchent à en finir avec le vieux monde, qui refusent les étiquettes.
C’est à cela que nous nous essayons dans cette revue, depuis vingt-cinq ans.
Le Grand Refus poétique Vers un anarchisme post-fondationnel largement irrigué par ses confins
